Arts | Le 9 février 2026, par Karine Josse. Format : livre numérique (33 feuillets).
« Cinéphilie(s) »
« L’exhaustivité, c’est un peu une ivresse » : entretien avec Christophe Bier, acteur et écrivain
Entretiens sur le cinéma et la cinéphilie
Christophe Bier est un homme des salles obscures, mais aussi des films obscurs et des seconds rôles inconnus. D’abord assistant du réalisateur Jean-Pierre Mocky, pour lequel il interprète également divers seconds rôles, il a peu à peu fait du cinéma et des acteurs méconnus, invisibles ou « bis » son territoire d’exploration. Auteur d’un monumental dictionnaire des films érotiques et chroniqueur infatigable, il arpente depuis des décennies les marges de la production cinématographique avec une érudition joyeuse, du cinéma fantastique au cinéma bis, des fanzines aux librairies spécialisées dans le cinéma. Au cours de cet entretien mené par Karine Josse pour la série « Cinéphilie(s) », il revient sur ses premiers chocs de spectateur — Fernandel, les films fantastiques, la salle parisienne du Brady —, sur sa participation à des événements comme l’Étrange Festival et les figures de libraires parisiens, mais aussi sur ce qui fait selon lui l’expérience du cinéphile et de l’amateur de cinéma : un lieu de découverte, de sociabilité, parfois de partage.
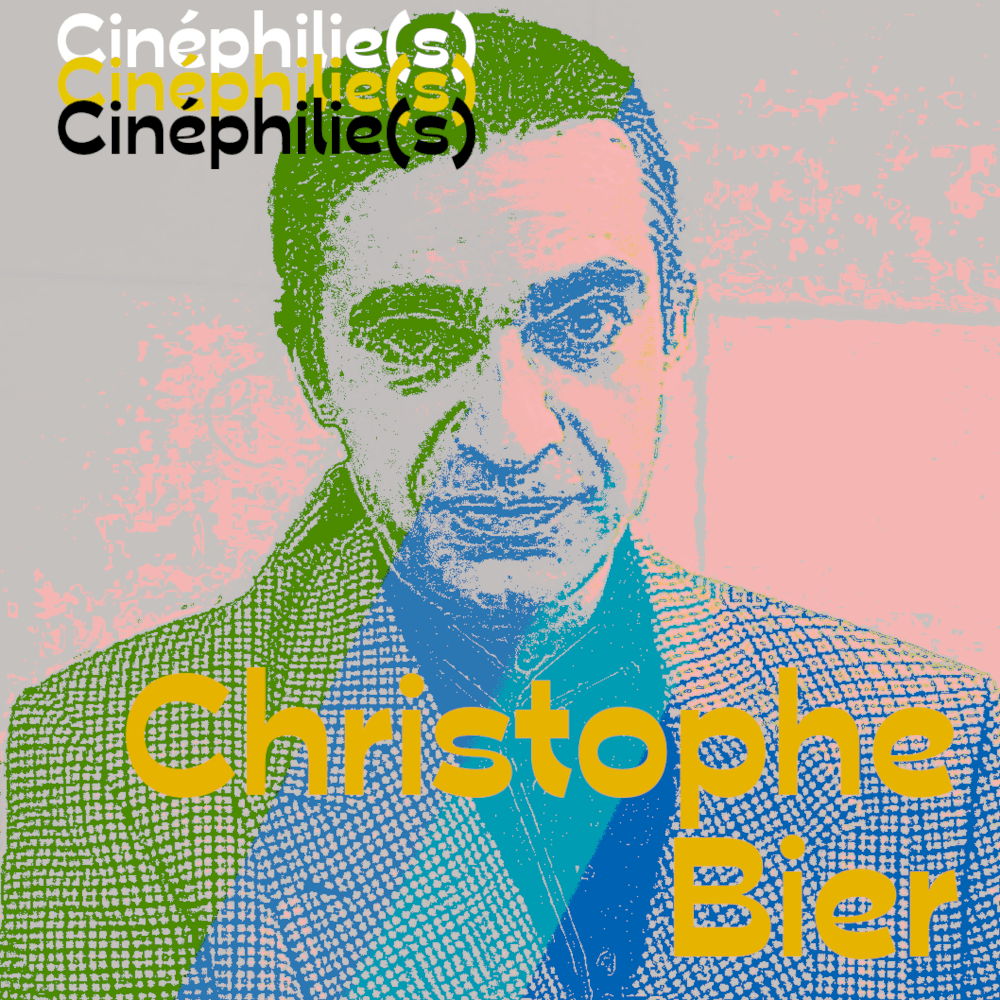
« Lorsqu’on veut être tout, finalement on n’est rien » : Christophe Bier, écrivain et acteur
J’aimerais bien n’être qu’une seule chose mais en fait, je suis ces deux choses-là, écrivain et acteur. Écrivain, c’est un terme un peu générique. Cela veut dire qu’on ne sait pas si j’écris des essais ou des romans.
Ch.B.
Karine Josse : Dans le cinéma, ce qui vous intéresse, est-ce l’exhaustivité ? On pense le comprendre en lisant vos chroniques pour Obsessions, dans lesquelles lorsque vous aimez un acteur, vous êtes capable de citer tous les films dans lesquels il a joué.
Christophe Bier : Oui, il y a chez moi une volonté d’exhaustivité. L’exhaustivité c’est ce qui me plaît le plus. C’est un peu une ivresse.
K. J. : C’est pour cela que vous aimez les dictionnaires ?
Christophe Bier : Le Dictionnaire des films érotiques et pornographiques est né d’une idée d’exhaustivité. Une idée un peu folle parce que c’est un domaine spécifique. La pornographie en 16 et en 35 mm, on peut facilement la cerner, mais les films érotiques nous ont posé plus de questions. Le terme d’érotisme ouvrait la porte à des interprétations. Et d’ailleurs, je regrette la présence de certains films dans le dictionnaire et l’absence d’autres. Par exemple, on aurait dû mettre Le genou de Claire d’Éric Rohmer. Je le regrette. J’ai découvert aussi il n’y pas longtemps, un film que j’aurais dû mettre. Il s’agit d’un film du réalisateur animalier Gérald Calderon sur la vie sexuelle des animaux. Un long métrage des années 60 qui s’appelait Le bestiaire d’amour et j’aurais été très heureux de le mettre dans le dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, il y avait quelques films à vocation pédagogique, d’éducation sexuelle. On aurait dû mettre ce film, cela aurait fait une notice extraordinaire. Ce réalisateur, je l’ai programmé à l’Étrange Festival cette année. C’est lui qui a réalisé La grande Paulette où il y a justement des plans d’animaux. Parce que là, je crois qu’on est passés à côté d’un film érotique, enfin érotique pour les animaux ou pour ceux qui aiment les animaux !
K. J. : Comment est-ce que vous souhaitez que l’on vous présente ?
Christophe Bier : Je dirais écrivain et acteur. J’aimerais bien n’être qu’une seule chose mais en fait, je suis ces deux choses-là. Écrivain, c’est un terme un peu générique. Cela veut dire qu’on ne sait pas si j’écris des essais ou des romans.
Pendant une grande période, il y a eu à Paris la librairie Un regard moderne, qui était un endroit exceptionnel. (...) Le libraire s’appelait Jacques Noël, et j’y allais toujours dans l’espoir de trouver un sujet de chronique, c’était un peu un passage obligé parce que dans cette librairie il y avait des choses que je ne trouverai nulle part ailleurs, différentes, transgressives, des manières insolites d’aborder certains sujets.
Ch.B.
Ce que je faisais avec mes chroniques dans Mauvais genre me permettait de garder les deux casquettes : écrivain et acteur, puisqu’elles étaient écrites puis interprétées. Les gens aujourd’hui veulent tout être. Et on ne peut pas avoir le talent pour tout. C’est-à-dire que lorsqu’on veut être tout, finalement on n’est rien. Mon ami Bertrand Mandico revendique d’être cinéaste même lorsqu’il dessine. Moi, j’aimerais arriver à la pureté de la pensée de Mandico lorsqu’il dit : « Je suis cinéaste et quoi que je fasse, je le fais en tant que cinéaste ». J’aime bien cette idée. Ce que veut dire Mandico, c’est que l’on est d’abord et avant tout quelque chose.
Je ne me considère pas comme un critique et historien du cinéma, c’est un peu pompeux. Reprenons l’exemple de Mauvais genre. Je jouais sur un contraste. Je ne me sentais pas dans le même univers que Jean-Baptiste Thoret par exemple. Je n’y intervenais pas comme critique de cinéma. Les Américains ont un terme que j’aime bien qui est entertainment. Je me sentais beaucoup plus dans cet esprit-là dans l’émission. Comme un acteur qui est là pour apporter un autre ton, de l’ordre du spectacle.
K. J. : Et en même temps vous y aviez un rôle de découvreur. On découvrait grâce à vous des choses complètement improbables : livre, artiste, film, etc.
Christophe Bier : Justement un critique de cinéma c’est un métier avec beaucoup de contraintes ; ils sont obligés de regarder les films qui sortent ; moi, je n’ai aucune contrainte de cet ordre. Ils n’ont certainement pas la possibilité que j’ai de découvrir des trucs à droite à gauche juste en me baladant. Pendant une grande période il y a eu à Paris la librairie Un regard moderne, qui était un endroit exceptionnel. Cet endroit a marqué beaucoup de personnes de ma génération. Le libraire s’appelait Jacques Noël, et il connaissait parfaitement sa librairie. Et j’y allais toujours dans l’espoir de trouver un sujet de chronique, c’était un peu un passage obligé parce que je savais que dans cette librairie il y avait des choses que je ne trouverai nulle part ailleurs, différentes, transgressives, des manières insolites d’aborder certains sujets.
Par exemple, il y avait un photographe japonais qui filmait des voyeurs dans un parc, c’étaient des scènes de voyeurisme donc, c’était la nuit. Il filmait aux infrarouges et puis on les voyait avec leurs pupilles blanches comme ça… c’était très étrange. De même, j’ai vu qu’un Allemand avait fait à compte d’auteur « un livre sur les acteurs habillés en gorille. On en a là dans des cadres très particuliers…
K. J. : Cette librairie Le regard moderne, on y trouvait énormément de choses ; pourtant, aujourd’hui avec Internet, et tout ce que cela permet, on a l’impression qu’on devrait trouver davantage. Ce n’est pas le cas ?
Christophe Bier : A l’époque je faisais mes propres recherches. Internet ce n’est pas la panacée, c’est une foire d’empoigne plutôt et les petits éditeurs, il y en a certains qui sont hors des radars. D’ailleurs, Jacques Noël était fort pour les dénicher il faut se renseigner. C’est comme ça que j’avais découvert, en province, une biographie de l’actrice du Grand-Guignol Paula Maxa, celle qui a le plus crié sur scène, comment avait-il pu avoir ça ? On peut trouver ça à la librairie théâtrale, mais bon, je suis privilégié étant à Paris. Il y a encore quelques libraires spécialisées, heureusement, mais celui qui est en province, eh bien, il doit faire une recherche ardue sur Internet justement. Au moins dans ce cas-là, c’est un outil utile. En revanche, les très grands libraires comme Jacques Noël faisaient ce travail pour leur public. C’était quand même quelqu’un de très étonnant. Il essayait d’aller au-devant du désir de son client. Et il avait une conception vraiment très curieuse de son métier, il se considérait comme une prostituée. Depuis qu’il est mort, beaucoup de gens en ont parlé, il y a eu des reportages sur lui. Grâce à lui, plein d’artistes très jeunes ont débuté et notamment grâce aux fanzines qu’il avait dans sa boutique, et qu’il prenait systématiquement.
Cinéphile ? Le premier choc cinématographique
En effet il y a eu un premier choc. (...) Le film, c’était Alibaba et les 40 voleurs de Jacques Becker avec Fernandel, mais à l’époque, je ne sais pas que c’est de Jacques Becker, ce que je retiens surtout c’est Fernandel. Fernandel pour moi devient une sorte de génie, quelqu’un d’incroyable.
Ch.B.
K. J. : Ce qui m’intéresse, c’est de voir les étapes qui vous ont amené à vous définir comme cinéphile ? Et déjà, est-ce que vous vous considérez comme cinéphile ? On pourrait commencer par un premier souvenir, un premier choc cinématographique.
Christophe Bier : Oui je suis cinéphile, c’est le cinéma qui occupe toute ma vie. D’ailleurs, je suis ignare en musique, je ne sais pas faire la différence entre courants ou disques. Je n’ai aucune enceinte, j’écoute la musique dans des conditions déplorables, je m’en fiche. C’est une faiblesse, j’écoute parfois de la musique de façon aléatoire. C’est comme si le cinéma avait tout accaparé dans mon imaginaire... Oui, je suis cinéphile puisque le cinéma occupe une part considérable de mon imaginaire. En effet il y a eu un premier choc, et le choc en l’occurrence est peut-être lié aux conditions particulières dans lesquelles j’ai vu le film. J’étais convalescent, je n’étais donc pas à l’école, j’étais resté chez moi et cela en soi était déjà plaisant.
K. J. : C’est vrai que le moment où l’on reçoit un film n’est pas anodin, et que l’expérience sensorielle peut-être centrale dans l’attachement au cinéma.
Christophe Bier : Le film, c’était Alibaba et les 40 voleurs de Jacques Becker avec Fernandel mais à l’époque, je ne sais pas que c’est de Jacques Becker, ce que je retiens surtout c’est Fernandel. Fernandel pour moi devient une sorte de génie, quelqu’un d’incroyable. C’est curieux, je ne sais pas si c’est le premier film que je voyais mais, ce qui m’a tout de suite intéressé, c’est l’acteur principal. À partir de là, j’ai voulu tout savoir sur Fernandel, tout voir. Il y avait des livres qui sortaient sur Fernandel, que j’ai achetés. Et donc, je dois avoir sept ou huit ans à ce moment-là, et ce qui me fascinait c’était la longue liste des films de Fernandel. Sa filmographie depuis les années 1930 jusqu’au film Heureux qui comme Ulysse en 1969. J’ai commencé, comme plein d’autres cinéphiles d’ailleurs, à faire des fiches, des filmographies. Puis, je me suis intéressé un peu à Bourvil et ainsi, de fil en aiguille, j’ai fini par m’intéresser au cinéma de façon plus générale, mais c’est Fernandel qui en a été le point de départ.
K. J. : Comment est-ce que cela s’organise, ce développement de votre passion, ce début de collection, alors que vous n’avez pas encore l’autonomie pour acheter seul ?
Christophe Bier : J’ai dû vraiment commencer à acheter des livres plutôt à l’adolescence. Ou bien, j’ai reçu des cadeaux d’anniversaire, des cadeaux de Noël, de gens qui savaient que je voulais des livres sur Fernandel. C’est un peu flou dans ma mémoire. Et je me souviens par exemple que j’avais bataillé pour voir un film qui passait le dimanche soir, alors qu’il y avait école le lendemain. Je voulais absolument voir le film ! Il n’y avait que trois chaînes et les journaux pouvaient déployer sur des doubles pages tout un argumentaire sur le programme du soir. Et il y avait d’ailleurs parfois jusqu’à six photos du film sur une seule page : le film du soir, c’était un événement ! C’était à 20h30 et je me souviens que ce film c’était La bourse ou la vie de Jean-Pierre Mocky, parce que j’avais vu qu’il y avait Fernandel dans le film.
Cinéma fantastique et librairies parisiennes
J’ai grandi à Rouen. Mais à Paris, se trouvait une librairie qui s’appelait Temps futur, installée rue Dante, et où l’on pouvait trouver des fanzines. (...) J’allais aussi régulièrement chez Contacts : on y trouvait tous les livres américains sur le cinéma, et même des livres dans d’autres langues.
Ch.B.
K. J. : C’était donc à la télévision ? Est-ce que vous alliez au cinéma en famille ?
Christophe Bier : Non, c’est moi qui ai imposé le cinéma. J’ai commencé à collectionner des trucs. J’achetais sur les marchés justement des films racontés en roman photos ; dans la famille, c’était mon domaine réservé, personne d’autre ne s’intéressait vraiment au cinéma.
Christophe Bier : Il y a un souvenir très précis qui me vient, c’est que dans le grand supermarché où mes parents faisaient leurs courses, j’ai découvert un grand hall de presse extérieur; j’y allais pour voir ce qu’il y avait dans le rayon cinéma, et là, j’ai vu une revue carrée qui m’a intrigué ; c’était une des formules de L’Écran fantastique ; je ne m’intéressais pas beaucoup au cinéma fantastique à l’époque, mais cette revue m’a tout de suite enthousiasmé.
Il y avait un article sur Erle C. Kenton, celui qui a réalisé L’Île de docteur Moreau en 1932. Et puis un dossier sur L’Invasion des profanateurs ; j’avais été tout de suite fasciné par l’article sur C. Kenton. C’était vraiment délirant de lire tout ça. Et les images étaient véritablement fascinantes. Après, on se disait qu’il fallait absolument voir ses films !
K. J. : Cela évoquait donc des films dont vous n’étiez pas sûr que vous pourriez les voir. Ce récit fantasmatique revient souvent dans les confessions des cinéphiles sur leur parcours. Cela créait une attente très forte qu’il n’y a peut-être plus aujourd’hui.
Christophe Bier : J’avoue que je ne sais plus trop dans quel état d’esprit j’étais. Après, j’étais abonné à la Revue du cinéma, une revue plus généraliste mais spécialisée aussi dans le cinéma bis le terme apparaissait beaucoup dans cette revue et elle faisait parfois écho à des fanzines. C’est comme ça que j’ai dû découvrir l’existence des fanzines ; j’ai découvert les fanzines à Paris.
K. J. : Et vous veniez d’où ?
Christophe Bier : J’ai grandi à Rouen. Mais à Paris, par exemple, se trouvait une librairie qui s’appelait Temps futur, installée rue Dante ; et là on pouvait trouver des fanzines. Dans toutes ces revues de cinéma, par ailleurs, on trouvait une publicité pour la boutique Contacts, rue du Colisée. Contacts était une librairie exceptionnelle, vous pouviez y trouver tous les livres sur le cinéma qui existaient. La personne qui tenait la libraire était une dame, dont j’ai découvert par la suite qu’elle avait débuté sa carrière comme strip-teaseuse et meneuse de revue au Crazy Horse Saloon ; elle avait un amour du livre qui passait devant tout le reste, et elle ne supportait pas que les clients malmènent les livres et mettent leurs doigts sur la tranche ; il y a même des gens qui étaient effrayés par cette dame. Je suis arrivé à Paris en 1988-1989, et j’allais régulièrement chez Contacts. On y trouvait tous les livres américains, et même des livres dans d’autres langues ; la patronne mettait des encarts publicitaires pour sa librairie dans toutes les revues de cinéma. De façon générale, on découvrait les librairies de cinéma en arrivant à Paris.
K. J. : J’ai connu Ciné reflets, rue Champollion ou Cinédoc passage Jouffroy.
Christophe Bier : Et puis il y en avait une dans un cinéma du XIVe arrondissement, rue de Pressensé. Le Libraire après a déménagé à d’autres adresses, dont la dernière était rue Broca ; il s’appelait Gérard Perron et était spécialisé dans les affiches. On en trouvait également une près de la tour Saint-Jacques, à Châtelet, où j’ai acheté beaucoup de lots de photos. C’était très facile de collectionner à cette époque.
K. J. : On va également parler un peu des salles. Il y avait le cinéma Accattone, installé rue Cujas, où il vendait également un peu de livres et faisait office de galerie.
Christophe Bier : Je ne connais pas bien ce cinéma, moi j’allais au Brady.
K. J. : Après cette passion pour Fernandel découvert à la télévision, quand allez-vous au cinéma seul pour la première fois ?
Quand j’avais douze, quatorze, seize ans à Rouen, il y avait des salles comme ça. Je me souviens avoir été frappé par l’affiche du Lac des morts-vivants, c’est un film Eurociné complètement fauché et que Jean Rollin n’avait même pas voulu signer. L’affiche, assez effrayante, était dessinée par cet homme formidable, Constantin Belinsky2, que j’ai fini par rencontrer en arrivant à Paris et que j’adorais.Je ne sais pas exactement si ce film était interdit aux moins de 18 ans. Sans doute plutôt aux moins de 13 ans. À l’époque, il n’y avait pas l’interdiction de 12 et 16 ans ; c’est arrivé avec Jack Lang.
Ch.B.
Christophe Bier : À Rouen, j’allais dans les salles Arts et essai. Je me souviens que j’ai découvert, sous l’influence de la lecture de la Revue du cinéma , le film Super Vixens.
K. J. : Et ce film était interdit avant quel âge ?
Christophe Bier : Je ne sais pas exactement si ce film était interdit aux moins de 18 ans. Sans doute plutôt aux moins de 13 ans. À l’époque, il n’y avait pas l’interdiction de 12 et 16 ans ; c’est arrivé avec Jack Lang, je ne sais plus en quelle année précisément mais en 1990 peut-être, il y a eu ce changement.
Mais c’était la télévision qui me fournissait le plus de films. En salle, j’y allais toutefois un petit peu – il y avait pas mal de salles de quartier, et j’aurais sans doute dû y aller plus souvent. Par exemple, il y avait une salle qui s’appelait Le chartreux et passait des films de karaté et des westerns ; à ce moment-là, je préférais aller voir Le salon de musique de Satyajit Ray, parce que j’avais lu un dossier dans la Revue du cinéma ; après je me suis orienté vers le cinéma en arrivant à Paris, et je me suis dit, « mince, j’arrive un peu tard », beaucoup de salles avaient disparu. Quand j’avais douze, quatorze, seize ans à Rouen, il y avait des salles comme ça. Je me souviens avoir été frappé par l’affiche du Lac des morts-vivants, c’est un film Eurociné complètement fauché et que Jean Rollin n’avait même pas voulu signer. L’affiche, assez effrayante, était dessinée par cet homme formidable, Constantin Belinsky2, que j’ai fini par rencontrer en arrivant à Paris et que j’adorais. J’ai d’ailleurs réalisé un documentaire sur la production de la compagnie Eurociné.
K. J. : Vous vous êtes rapidement spécialisé dans ce qu’on appelle le cinéma bis, mais vous avez tout de même connu une phase art et essai ?
Christophe Bier : Oui mais c’est normal, je veux dire : heureusement ; ceux qui ne voient que du cinéma bis et qui n’ont même pas jamais vu un seul film de Bergman passent à côté de toute une histoire du cinéma. Ce qui est intelligent, c’est peut-être de ne pas vouloir voir des films insipides ; s’épargner des films extrêmement commerciaux qui n’ont vraiment pas tellement d’intérêt.
K. J. : Finalement, vous faites une différence entre « aller au cinéma » et « aller voir un film » ? Allez au cinéma comme une habitude, ou bien aller voir un film spécifique, ce n’est pas la même démarche ?
Christophe Bier : Ah oui, certes, moi j’allais voir un film. Il y a par exemple un film allemand que j’adore, qui s’appelle Le mort dans le filet et là aussi, c’est lié à un souvenir d’adolescence. C’était chez ma tante, qui est lorraine ; je voyais des films avec elle et parfois, c’était des films en langue allemande. Un jour, j’ai visionné avec elle un film où des filles sur une île sont mordues par une araignée et se transforment en monstre ; longtemps, ce film m’a obsédé. Je ne savais pas ce que c’était que ce film et ce n’est que plus tard que j’ai découvert que c’était Le Mort dans le filet, un petit film allemand que le critique Ado Kyrou avait encensé dans Positif. Après, quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert une revue qui s’appelait Fascination, entièrement conçue par Jean-Pierre Bouyxou3 ; là aussi, il avait fait quatre pages délirantes sur Le Mort dans le filet, ça fait partie des films que j’ai ensuite cherché à revoir, de ma formation de cinéphile ; et qui montre aussi que je fais fréquemment un pas de côté, que j’aime m’aventurer dans des chemins de traverse.
« Le 35 mm, c’est tout de même autre chose »
K. J. : Vous pensez qu’on peut être cinéphile sans fréquenter les salles ?
Christophe Bier : Oui, puisqu’on peut avoir des titres comme ça en DVD ; je trouve ça formidable d’être dans une salle, mais si c’est pour voir des DCP4, les choses perdent de leur saveur ; moi, ce qui m’intéresse, c’est lorsque je vais à la Cinémathèque française aux séances de cinéma bis, et qu’on se trouve face à une copie 35 d’exploitation5, et ça c’est vraiment bien.
K. J. : C’est ce qui vous fait vous déplacer ?
Christophe Bier : Le 35 mm, l’argentique, c’est tout de même autre chose ; c’est quelque chose d’organique et de chimique surtout ; ce qui est dommage, c’est que les cinémathèques (par facilité peut-être, ou poussées par les demandes de leur public) se tournent de plus en plus vers des fichiers numériques au lieu d’éduquer le public à apprécier des copies en 35 mm voire 16 mm ; évidemment, pour les films conçus originellement en numérique, c’est différent. En plus, ce nouveau public veut toujours que ce soit parfait, léché. Je me souviens qu’au Brady on voyait parfois certains films en Eastmancolor6, dont les couleurs avaient viré. C’était des copies magenta. Ça fait partie de l’expérience d’une salle.
Sociabilité
K. J. : Et l’expérience de la salle comme expérience de sociabilité qu’est-ce que vous en pensez ?
Christophe Bier : Non je trouve ça un peu pénible parfois d’être avec des gens. Soit la salle est pleine et alors c’est un peu comme si on était seul mais si c’est une salle clairsemée et que quelqu’un à côté de vous s’agite vous préférez vous déplacer pour être tranquille. Mais j’aimais bien le public du Brady qui était un public assez pittoresque ; une fois, j’ai vu un film d’espionnage sur le FBI, Opération Vipère jaune ; j’y vais à 14h, la première séance, et je savais que la copie était fragile ; elle avait dû casser une fois ou deux. Nous, on a vu le film et j’en ai un très bon souvenir, mais le film était tellement en mauvais état que le projectionniste a renoncé à le projeter une fois de plus. Le film n’est passé qu’à 14h et en sortant du film, il y avait un vieux cinéphile qu’on connaissait tous, qui était facilement reconnaissable avec sa barbe, un spécialiste de péplum et de cinéma fantastique. Il était quasiment en larmes parce qu’il apprenait que le film était déprogrammé ; qu’il ne serait peut-être plus jamais projeté. De mon côté, j’avais une sorte de satisfaction un peu sadique à me dire : Je suis un des derniers spectateurs avoir vu ce film ! Tout à coup ce cinéphile en larmes contribue au souvenir que j’ai du film.
K. J. : Il y a un rapport de la cinéphilie à la rareté qui évolue sans doute avec la profusion des films accessible en ligne. Y compris les efforts qu’aujourd’hui un cinéphile est capable de fournir pour voir un film. Certains témoignages, par exemple dans le livre Le Brady, le cinéma des damnés, rappellent que les cinéphiles pouvaient se déplacer d’une ville à l’autre, organiser tout leur emploi du temps en fonction de certains films.
Christophe Bier : Tout le monde connaît l’histoire du groupe des mac-mahoniens7, ces cinéphiles des années 1960 qui allaient à Bruxelles pour voir des films : Yves Boisset, Bertrand Tavernier ou Patrick Brion. Ils allaient tous à Bruxelles pour voir un film rare de Boetticher ou même de Joseph Kane. Moi, je suis comme eux, mais avec un objectif précis en tête. Pour le dictionnaire des films érotiques et pornographiques, on a vu énormément de films à la Cinémathèque française et aux Archives françaises du film. Et là, depuis quelques années, j’ai un projet, un livre à faire sur un figurant : Monsieur 027 ; c’est son matricule puisque, à défaut d’avoir un nom, un petit groupe de spécialiste des figurants l’a numéroté. C’est peut-être ça qui m’intéresse maintenant, de faire des choses qu’on ne peut pas faire on arrivera jamais à aller au bout de l’exhaustivité de la carrière de Monsieur 027 il est dans 613 films ; en l’occurrence, le 613e, je l’ai trouvé hier grâce à un petit fascicule. On pense évidemment à Londres après minuit8 : il faut alors se contenter d’un dossier de presse de l’époque.
K. J. : Y a-t-il des films qui ont complètement disparu ?
Christophe Bier : Oui, il y a des films qui ont totalement disparu parce que les studios voulaient récupérer la pellicule. On pense que c’est surtout réservé au cinéma muet mais dans le cinéma parlant aussi des choses ont disparu. Il y a parfois une copie dans une Cinémathèque, ça devient comme des incunables ; et c’est pour ça que c’est un peu malheureux que l’on donne toujours énormément d’argent au CNC pour la restauration des mêmes films. Je préférerais qu’on donne l’argent d’une restauration 4K de la Règle du jeu à une dizaine d’autres petits films qui attendent d’être restaurés. Par exemple Le chant d’amour, un film de 1935 de Gaston Roudet avec mon figurant 027, ce film-là, je crois malheureusement qu’il est invisible. Je suis allé pendant une semaine à Toulouse où la Cinémathèque m’a accueilli dans le cadre de mes recherches sur 027, et j’ai vu pendant cinq jours trois films par jour ; j’avais ma programmation établie à partir de leur copie 16 et 35 mm ; quinze films impossibles à trouver sur Internet ou en DVD.
Collectionneurs, passionnés et cinéphages
K. J. : Vous avez un rôle intéressant en tant que dénicheur de films, notamment lorsque vous proposez vos cartes blanches à L’Étrange Festival, avec des films invisibles ailleurs.
Christophe Bier : J’ai vu à Toulouse L’Or de la rue de Curtis Bernhardt, c’est un film qui est dans l’escarcelle Gaumont, j’ai donc dit à Sylvain Perret qu’il fallait absolument restaurer ce film et qu’on pourrait le projeter à L’Étrange Festival l’année prochaine. J’ai un statut privilégié, même si je ne vois pas ces films en salle, mais sur une table de visionnage avec le bruit de la machine ; mais cela reste un privilège.
K. J. : Le cinéphile est un passionné qui aime parler de ce qu’il aime, mais le cinéphile est-il forcément un passeur ?
Christophe Bier : Je crois qu’il y a des gens qui sont très égoïstes dans ce domaine-là, et pour eux, le grand plaisir c’est d’avoir vu le film que personne n’a vu.
K. J. : Cela rejoint la question du cinéphile qui est ou n’est pas selon les cas un collectionneur ?
Christophe Bier : Les collectionneurs sont des gens parfois un peu dangereux, un peu bizarres dans le partage, oui ; peut-être parce que parfois, c’est leur seul lien social, et que, quand ils sont véritablement plongés dans le cinéma jusqu’au cou, rien d’autre n’existe.
K. J. : Par exemple, si on s’en réfère à ce qu’on appelait les mac-mahoniens, il semble que les débats étaient tellement passionnés, leur volonté de convaincre tellement intense qu’ils pouvaient en arriver aux mains…
Christophe Bier : Il y avait peut-être plus de passion à l’époque ; je crois que les gens ont aujourd’hui un peu peur d’être passionnés ; je pense que quelqu’un comme Jean-Baptiste Thoret sera toujours là pour défendre bec et ongles tel ou tel cinéaste et qu’il a pas peur de la foire d’empoigne. L’émission Le Club a forgé aussi sa réputation sur des discussions qui peuvent être assez musclées, entre critiques. Maintenant, il n’y a plus eu de bataille d’Hernani depuis des décennies, c’est vrai.
K. J. : Est-ce que vous pensez que pour être cinéphile et vraiment apprécier les films, il faut forcément avoir un savoir technique ?
Christophe Bier : Avoir du plaisir à voir des films c’est ça qui est le plus important. Je connaissais un cinéphile qui à chaque fois qu’il avait vu un film disait toujours la même phrase, « C’est un bon film, au demeurant », quel que soit le film ; un jour, il a émis une vague remarque, et cela constituait en quelque sorte un cataclysme… Vraisemblablement que son bonheur, à lui, c’était d’être dans un cinéma ou de voir un film, et quel que soit le film c’était toujours pour lui « un bon film, au demeurant », aussi je pense qu’il se fichait bien de ces histoires de valeur de plan, de montage ; tout ça n’avait aucun intérêt pour lui, du moment que c’était un film et qu’il passait un bon moment.
La cinéphilie a d’abord été populaire, avant que n’arrive une critique « haut de gamme ». Très populaire et pour le très grand public : d’abord ce fut juste cela, le plaisir d’aller au cinéma, une sorte de fascination pour pour le 7e art.
K. J. : Être cinéphile c’est donc d’abord voir beaucoup de films ?
Christophe Bier : C’est simplement aller au cinéma ou aimer voir des films.
K. J. : Vous ne faites donc pas la différence, comme la concevait Henri Langlois, entre cinéphage et cinéphile ? Le cinéphile étant celui qui est capable d’articuler un discours sur le film ?
Christophe Bier : Non, car cela sous-entend que le terme de cinéphile se confond un peu avec celui de critique. Un cinéphile n’est pas forcément quelqu’un qui peut articuler un discours.
Parmi les collectionneurs que j’ai pu rencontrer, il y avait par exemple un postier qui collectionnait des revues de cinéma. Ce qui comptait pour lui, c’étaient les acteurs qu’il aimait. D’ailleurs, chaque année à la foire d’Argenteuil9, lorsqu’il venait vendre ses doubles, il prenait plusieurs mètres de stand et tout était classé par acteur.
La cinéphilie, entre « politique des acteurs » et récit de soi
Je crois que les acteurs sont essentiels. Les films qui ont peur des acteurs, cela se voit immédiatement. Ils essaient de gommer l’intérêt des rôles, utilisent les comédiens comme des marionnettes pour mettre en valeur le cinéaste. Ce sont des films extrêmement formalistes, qui se vident un peu de leur substance, et se réduisent à des jeux avec l’image.
Ch.B.
Les acteurs priment souvent dans l’entrée en cinéphilie. Je doute que des cinéphiles ou de futurs critiques, à six ou sept ans, soient subjugués par la mise en scène d’un film. La plupart du temps, le souvenir se rattache à un acteur — ou alors c’est Blanche-Neige et les sept nains.
K. J. : C’est vrai qu’il y a eu une influence de la politique des auteurs sur le regard porté sur les films. C’est peut-être à partir de ce moment-là que le spectateur lambda a davantage fait attention à la mise en scène.
Christophe Bier : Je crois beaucoup à une politique des acteurs. Luc Moullet10 a écrit un livre là-dessus, très bien fait, où il prend trois ou quatre acteurs hollywoodiens pour définir la manière dont ils influencent l’esthétique d’un film. La critique, et surtout la critique constructive et enthousiasmante, nous ouvre des portes. Mais c’est comme si parler des acteurs n’était pas assez valorisant pour elle. En tout cas, la critique française s’attache énormément au réalisateur, au scénariste, à l’image — les acteurs y sont une quantité un peu négligeable. De temps en temps, une revue importante consacre un dossier à « l’acteur au cinéma », puis retourne à ses habitudes et parle de mise en scène, comme si le livre de Luc Moullet n’avait jamais existé. Lui a pris une sorte de contre-pied : il ne nie pas la politique des auteurs, mais il affirme qu’il existe aussi une politique des acteurs. Je crois que beaucoup de cinéphiles y sont sensibles.
K. J. : Effectivement, j’ai l’impression que l’entrée en cinéphilie se fait davantage par la figure de l’acteur, d’abord parce qu’on s’identifie à lui, notamment lorsqu’on entre jeune en cinéphilie.
Christophe Bier : Oui, je crois que les acteurs sont essentiels. Les films, aujourd’hui, qui ont peur des acteurs, cela se voit immédiatement. Ils essaient de gommer l’intérêt des rôles, utilisent les comédiens comme des marionnettes pour mettre en valeur le cinéaste. Ce sont des films extrêmement formalistes, qui se vident un peu de leur substance, et se réduisent à des jeux avec l’image. Des films faussement commerciaux, en réalité expérimentaux, des films de cinéaste au mauvais sens du terme, d’abord là pour servir l’ego du réalisateur. Il y a cette tendance actuelle à déconstruire les genres cinématographiques, pour montrer qu’on est plus malin que le genre lui-même, ce qui passe par la déconstruction des archétypes et donc par une maîtrise du jeu des acteurs. On voit bien que certains réalisateurs choisissent des acteurs sans qu’on puisse même juger de leur jeu, tant ils sont noyés dans la masse, filmés sans être servis par la mise en scène. Il y a il me semble cette tendance, chez certains cinéastes qui ne sont pas à l’aise avec les acteurs, comme s’ils percevaient ceux-ci comme un danger pour leur ego. Un réalisateur intelligent voit à quel point un acteur peut servir son propos et se mettre au service du film. Je ne pense pas que Max Ophuls, par exemple, avait peur de Danielle Darrieux.
K. J. : La conversation autour du film fait partie du plaisir du cinéphile. Pensez-vous que parler de film soit en quelque sorte une manière de se raconter ?
Christophe Bier : C’est d’ailleurs pour cela que j’ai eu beaucoup de difficultés à trouver des rédacteurs pour mon dictionnaire du film porno. Les rédacteurs potentiels devaient être confrontés à un matériau très peu commenté jusqu’alors et qui touche à l’intime. Comme j’avais une exigence critique forte, j’avais posé deux interdits pour ce travail : je ne voulais absolument pas qu’on fasse la moindre remarque sur le physique d’un comédien, et encore moins d’une comédienne — ce n’est pas un argument, c’est beaucoup trop subjectif et déplaisant. Le second interdit était de ne pas adopter un regard surplombant, de bannir tout second degré qui utiliserait le film pornographique comme prétexte pour mettre en valeur son propre humour ou sa propre distance — traiter le film avec condescendance. Ces deux règles ont fait que certains rédacteurs n’ont jamais travaillé sur le dictionnaire. Le second écueil existait sans doute parce que les gens sont très mal à l’aise avec l’image pornographique, et que parler sérieusement d’un film pornographique revenait à exposer un peu son intimité, sa propre position vis-à-vis du sexe. On peut pourtant parler de ces films comme de n’importe quel autre, mais pour certains rédacteurs, il y avait la perception d’un danger à l’idée de se dévoiler.
Dans d’autres domaines aussi, le critique a toujours tendance à se dévoiler un peu, surtout s’il a des enthousiasmes marqués. Ce sont les critiques que je préfère : ceux chez qui je perçois une vraie vision des choses. L’ironie est pour moi rédhibitoire, et la technicité pure, lorsque le critique ne fait que disséquer des plans sans engagement, ne m’intéresse pas. C’est pour cela que j’ai toujours été sensible au discours critique d’Ado Kyrou11, qui venait du surréalisme. Il n’était pas tout à fait un critique de cinéma au sens classique. Il emportait le lecteur vers des rivages inconnus. Toute démarche critique révèle un tempérament, une position politique, une façon de voir le monde, une vision philosophique. C’est pour cela que ce spectateur qui trouvait tous les films bons me semblait étrange : cela n’exprimait aucun goût particulier, si ce n’est le plaisir d’être dans une salle et de voir un film. C’était peut-être déjà beaucoup, peut-être était-ce le spectateur idéal.
K. J. : Certaines images persistent en nous avec le temps, certains films nous ont marqué très tôt et signent certaines de nos obsessions. On connaît votre passion pour les nains au cinéma, seriez-vous en mesure de la dater ?
Christophe Bier : Oui, il y a eu Les Mystères de l’Ouest vu à la télévision, avec Michael Dunn jouant le docteur Loveless. J’étais emballé par ce personnage de méchant complètement fou. Ensuite, il y a eu le Cinéma de minuit de Patrick Brion, avec un cycle Tod Browning, et bien sûr Freaks, que j’ai dû voir à douze ou treize ans. Ce film m’a vraiment marqué, il est tellement étonnant. En fait, ce n’est pas tant dans le cinéma que je trouve des réponses à cette obsession, c’est plutôt lorsque je prends du recul et que je me souviens de détails personnels qui expliquent pourquoi j’aime tel ou tel film. J’ai toujours été sensible aux personnages reclus, en marge, rejetés. C’est quelque chose de très lié à ma cinéphilie et à ma façon de voir les choses. Le cinéma fantastique est d’abord pour moi le cinéma des réprouvés. Quand je lisais la revue L’Écran fantastique, avec des photos du monstre de Frankenstein, c’était évidemment lié à cela. Dans le fantastique, il y a toujours eu un grand écart : ceux qui y voient quelque chose de l’ordre de la transgression de l’ordre établi, et ceux qui n’y voient rien de tout cela et se situent plutôt du côté de l’ordre, de l’ordre à tout prix, du conservatisme. Il y a d’ailleurs de plus en plus de cinéphiles conservateurs, y compris dans ce domaine.
Les cinéphiles et le temps
J’ai développé une nouvelle façon de voir des films : je les dilate, je les compresse, le temps devient élastique. Je ne peux évidemment pas faire cela dans une salle de cinéma, mais chez moi, je peux accélérer le film, et dès qu’il y a une scène de figuration qui m’intéresse, je la dilate. Une scène de deux ou trois minutes peut alors durer près de quinze.
Ch.B.
K. J. : Certains critiques parlent, à propos du cinéma de genre, d’un héritage de la réparation pour des cinéphiles qui se sont longtemps sentis isolés et qui sont aujourd’hui au contraire très nombreux. Certains cinéphiles adeptes du genre dans les années 1970 et 1980, notamment ceux qui vivaient en province, m’ont confié qu’ils se sentaient alors isolés.
Christophe Bier : Oui, mais il y avait quand même les revues, les fanzines. Cette culture de la réparation implique l’idée d’être une victime, et c’est cela qui me gêne : cette tendance à se draper dans la victimisation. Je pense qu’on peut voir les choses de façon beaucoup plus positive.
K. J. : Et l’idée de film culte, est-ce que cela vous parle ?
Christophe Bier : Ce n’est pas une expression formidable. C’est extrêmement vulgaire, un peu frelaté, très commercial. Cela implique que tout le monde doit aimer le film. Il y a d’autres façons de parler des films.
K. J. : Pensez-vous qu’il y ait forcément une part de nostalgie dans la cinéphilie ?
Christophe Bier : Il y a beaucoup de cinéphiles qui voient les films qui sortent, mais moi je suis plutôt tourné vers le passé. Je regarde très peu de films récents. Je rate sans doute des choses parmi les films qui sortent, mais ce n’est pas très grave !
J’ai développé une nouvelle façon de voir des films : je les dilate, je les compresse, le temps devient élastique. Je ne peux évidemment pas faire cela dans une salle de cinéma, mais chez moi, je peux accélérer le film, et dès qu’il y a une scène de figuration qui m’intéresse, je la dilate. Une scène de deux ou trois minutes peut alors durer près de quinze. C’est une façon particulière de revoir les films en s’attachant aux figurants. Le film devient un autre objet. Quand je regarde un film dans cet esprit, en scrutant tous les visages en arrière-plan, c’est comme si j’inventais une autre façon de voir, un nouveau plaisir. Il y a un autre film dans le film, d’autres acteurs, d’autres personnages. Les acteurs de premier plan disparaissent littéralement, n’ont plus aucune importance, et c’est au fond de l’image que tout se joue. Je crois que je suis allé aussi loin que possible dans ma fétichisation des marges, de l’ombre. Avant, j’adorais les freaks ou les méchants dans les films, ceux qui ne sont pas dans la norme. Maintenant, avec un peu de sagesse, ce n’est plus la transgression ultime pour moi : c’est d’être dans l’ombre, voire dans le hors-champ. Il n’y a même plus à avoir une revendication quelconque. C’est une nouvelle façon de voir les films.
Seconds rôles et figurants
K. J. : Avant de vous intéresser au figurant, vous vous êtes longuement intéressé aux seconds rôles du cinéma français.
Christophe Bier : Oui, c’est comme si j’allais encore un peu plus loin.
K. J. : Et vous avez été chasseur de têtes pour Jean-Pierre Mocky12 ?
Christophe Bier : Oui, mais avec Mocky je m’occupais déjà de figuration. La figuration a toujours été pour moi une sorte de prolétariat anonymisé du cinéma. Ces gens-là n’ont pas de nom, ils ne figurent pas au générique. On ne peut pas faire plus éprouvé qu’un figurant. Ce qui m’a intéressé dans le travail que j’ai entrepris, c’est de retourner ce côté anonyme en une force. Je ne suis pas dans une victimisation de la figuration, contrairement au discours souvent entendu — « il aurait pu être une vedette » et ainsi de suite. Pour moi, être cantonné dans l’ombre, dans le hors-champ, en bord de cadre — un bord de cadre pouvant rapidement devenir hors-champ — c’est peut-être une force exceptionnelle. Ce sont peut-être eux qui ont tout compris.
K. J. : Ce figurant est au cœur de votre prochain projet de livre.
Christophe Bier : Oui, le projet est mûr, il sera publié l’année prochaine. D’ici là, je vais sans doute encore découvrir des films où mon figurant est apparu. C’est inévitable. Il en est à 613 films, de La Fin du monde d’Abel Gance au Samouraï de Melville. Un figurant devient pour moi une sorte de transgression parfaite, idéale. Avec un peu de recul, je comprendrai sans doute la logique de tout cela. Lorsque je me suis intéressé à Jean-Pierre Mocky, c’étaient les gens que l’on voyait dans ses films qui m’intéressaient, notamment Jean-Claude Rémoleux13, un personnage extraordinaire qui, en dehors de l’univers de Mocky, se retrouvait souvent dans la figuration. Avec Mocky, j’avais tout de suite compris que j’avais affaire à un auteur, mais il y avait aussi énormément d’acteurs dans son univers. Mocky n’avait pas peur des acteurs. Ma plus belle découverte est une comédienne qui s’appelle Evelyne Harter14. Elle n’a joué que dans les films de Mocky, puis elle a estimé que ses vacances étaient plus importantes que de tourner dans le prochain film. Elle a refusé un rôle et cela a été un drame. Mocky, parfois un peu vif, ne l’a jamais rappelée. Elle est formidable dans Le Glandeur, sans doute son plus beau rôle, où elle joue la femme de Mocky. À l’époque, j’étais au Secours catholique comme objecteur de conscience et elle travaillait dans un service social, mais je savais déjà qu’elle était faite pour le cinéma de Mocky. Elle a même eu droit à deux lignes dans une critique de Libération sur le film Vidange. Cela fait partie de mes titres de gloire d’avoir pu apporter dans l’univers de Mocky une personnalité aussi exceptionnelle. À l’époque, j’en croisais pas mal, et si j’avais su que je m’y intéresserais des années plus tard, il y a des tas de gens que j’aurais interviewés. Mais on ne peut pas faire deux choses en même temps, j’étais alors l’assistant de Mocky. Je le regrette un peu parce que beaucoup d’entre eux sont morts maintenant.
Ce n’est pas vraiment la nostalgie qui domine ici, mais plutôt un sentiment de mélancolie. Les gens disparaissent, et si l’on n’y prend pas garde, on perd leur témoignage. Ils demeurent un peu comme des fantômes. Je suis entouré de fantômes. La nostalgie me semble un sentiment un peu morbide, qui consiste uniquement à regretter ce qui fut, peut-être même avec une pointe de ressentiment. La mélancolie, elle, permet davantage d’accepter les choses comme elles sont tout en gardant le souvenir du passé, une cohabitation. J’ai l’impression que c’est un sentiment plus constructif. On vit entouré de fantômes sans que cela nous affecte outre mesure.
Il y a là-dedans quelque chose qui me dépasse un peu. Mon figurant 027, par exemple, est mort en 1972, et j’ai l’impression de le faire revivre. Pour moi, il est vivant, parce que nous cohabitons depuis quatre ou cinq ans maintenant. Il fait partie de mes obsessions quasiment quotidiennes. Cela n’a rien à voir avec un deuil. Un film documentaire est également prévu sur ce figurant, réalisé par Philippe Truffault, l’homme qui participe à la série Blow Up sur Arte.
Mémoire
K. J. : Aviez-vous une salle fétiche pour voir les films ? Sans doute le Brady ?
Christophe Bier : Oui, j’allais surtout au Brady. Et cela fait partie de mes regrets : j’aurais pu fréquenter beaucoup plus d’autres salles à l’époque, mais on n’a pas conscience que certaines choses vont disparaître, surtout lorsqu’on est jeune. Je suis quand même allé au Paris Ciné, qui existe toujours sous le nom de Cinéma Archipel. J’étais également allé au Strasbourg et une fois au Trianon. C’est dommage, j’aurais dû aller plus souvent dans ces salles, mais c’est au Brady que j’allais le plus. C’était ma salle favorite. Je connaissais très bien le projectionniste du Brady, M. Fournier, un homme charmant, accueillant avec sa clientèle et notamment avec les amateurs de fantastique. Il y a eu une période où il faisait tout dans le cinéma : la caisse, la projection, la programmation. Je crois que c’est en 1994 que Mocky a repris le Brady.
J’aurais voulu faire un film sur Mocky, mais plutôt sur ses acteurs, y compris les plus petits. Quand je suis arrivé à Paris, je les ai tous rencontrés, tous ceux qui étaient encore vivants, puis il a fallu que je rencontre Mocky. C’est comme cela que je me suis retrouvé acteur dans ses films. Mais dès notre rencontre, il m’a demandé de recruter des figurants, et à chaque film j’en faisais un peu plus. Il m’avait perçu comme quelqu’un connaissant bien cet univers. Avec lui, on parlait énormément d’acteurs. Il avait une très grande mémoire, y compris des petits rôles présents dans ses films.
K. J. : Une dernière question, un exercice toujours très compliqué. Pourriez-vous me citer cinq à dix films, non pas vos films préférés, mais cinq à dix films qui auraient jalonné votre parcours de cinéphile ?
Christophe Bier : Il y aurait un film de Mocky, La Cité de l’indicible peur (1964), c’est son chef-d’œuvre. Il y a Ali Baba et les quarante voleurs avec Fernandel. Je me souviens être allé en salle en 1984, j’avais dix-huit ans, et avoir trouvé le film formidable — c’est un souvenir de salle assez fort. Je m’étais aussi occupé d’un ciné-club au lycée où j’avais programmé La Grande Lessive. Il faudrait citer un film de Tod Browning : plutôt que Freaks, je citerai L’Inconnu, un film qui me touche encore plus, avec Lon Chaney. Il y a aussi Le Mort dans le filet. Le problème de cet exercice, c’est qu’on répond toujours à partir d’aujourd’hui, ce qui biaise un peu les choses, mais L’Inconnu, je l’ai vu à la télévision. Avec le recul, je citerai aussi L’Armoire volante avec Fernandel, et La Fin du jour de Julien Duvivier.
Karine Josse
Notes et références
Note 1. Christophe Bier, Le Brady cinéma des damnés, Paris, Verticales, 2015.
Note 2. Constantin Belinsky (1904-1999) était un affichiste, peintre et sculpteur français d’origine ukrainienne.
Note 3. Jean-Pierre Bouyxou (1946-2025), journaliste, critique et réalisateur français.
Note 4. Format numérique.
Note 5. « Copie 35 d’exploitation », ou copie d’exploitation en 35 mm, format de pellicule le plus utilisé dans le cinéma argentique. Une copie d’exploitation est un tirage cinématographique correctement étalonné et destiné à la projection en salles.
Note 6. Procédé de cinématographie en couleurs, créé en 1950 par Eastman Kodak, et utilisé dans de nombreux films de cette décennie.
Note 7. Mac-mahoniens et mac-mahonisme, courant critique des années 1950 et du début des années 1960, nommé en référence au cinéma parisien Le Mac Mahon, et affirmant la primauté de la mise en scène sur le scénario.
Note 8. Londres après minuit (1927) est un film muet américain réalisé par Tod Browning, et qui est aujourd’hui considéré comme perdu.
Note 9. La Foire du Cinématographe, fondée en 1988 dans la ville d’Argenteuil, et devenue depuis le festival Les Cinglés du Cinéma.
Note 10. Luc Moullet (né en 1937) est un réalisateur, producteur et critique de cinéma français. Il est l’auteur d’une quarantaine de films, dont *Les Contrebandières*, *Une aventure de Billy le Kid*, *Genèse d’un repas* et de nombreux courts métrages.
Note 11. Auteur de l’essai Le Surréalisme au cinéma, Adonis A. Kyrou (1923-1985) est un écrivain et réalisateur français d’origine grecque.
Note 12. Réalisateur et scénariste français, Jean-Pierre Mocky (1929-2019) signe notamment les films Solo (1970), À mort l’arbitre (1972), ou encore la série télévisée Myster Mocky présente (2007-2009, 2013-2019).
Note 13. Acteur français jouant souvent des rôles secondaires, Jean-Claude Rémoleux (1923-1985) est une figure récurrente des films de Jean-Pierre Mocky, à l’instar de Jean Abeillé ou d’Antoine Mayor.
Note 14. L’actrice Evelyne Harter est connue pour ses rôles dans des films de Jean-Pierre Mocky, comme Bonsoir (1994), Le Glandeur (2000) ou encore Les Araignées de la nuit (2002).
Entités nommées fréquentes : Bier, Le, Jacques Noël, Paris, Fernandel, Jacques Becker, Contacts, Et, Je, Rouen, Revue, Eurociné, Oui, Brady, Cinémathèque, Internet, Vous, Étrange Festival, Il, Non, La, Ce, Jean-Pierre Mocky, Mocky, Le Mort, Tod Browning.
L’actualité : derniers articles
« Journal culturel »
Hussey, Scherban, Schoshany : trois anniversaires d’artistes
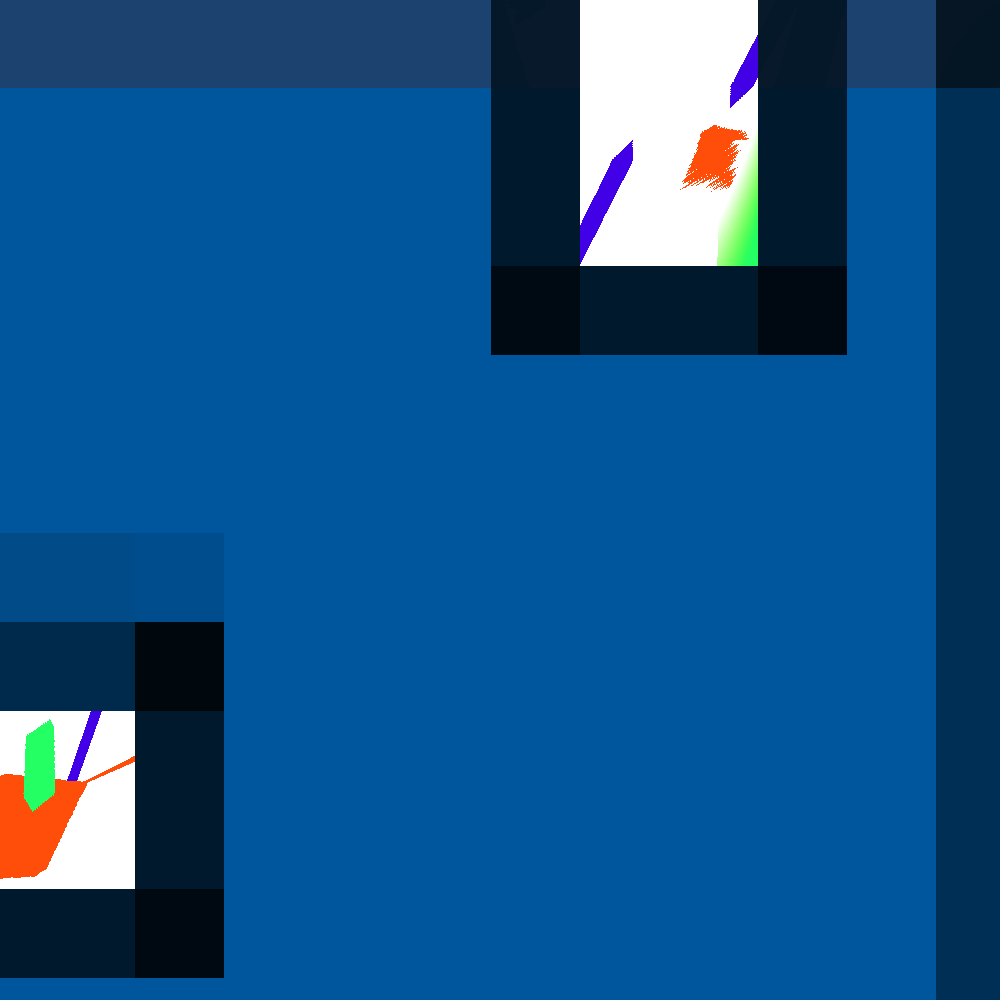
Arts | Le 10 février 2026, par Sambuc éditeur.
« Cinéphilie(s) »
« L’exhaustivité, c’est un peu une ivresse » : entretien avec Christophe Bier, acteur et écrivain
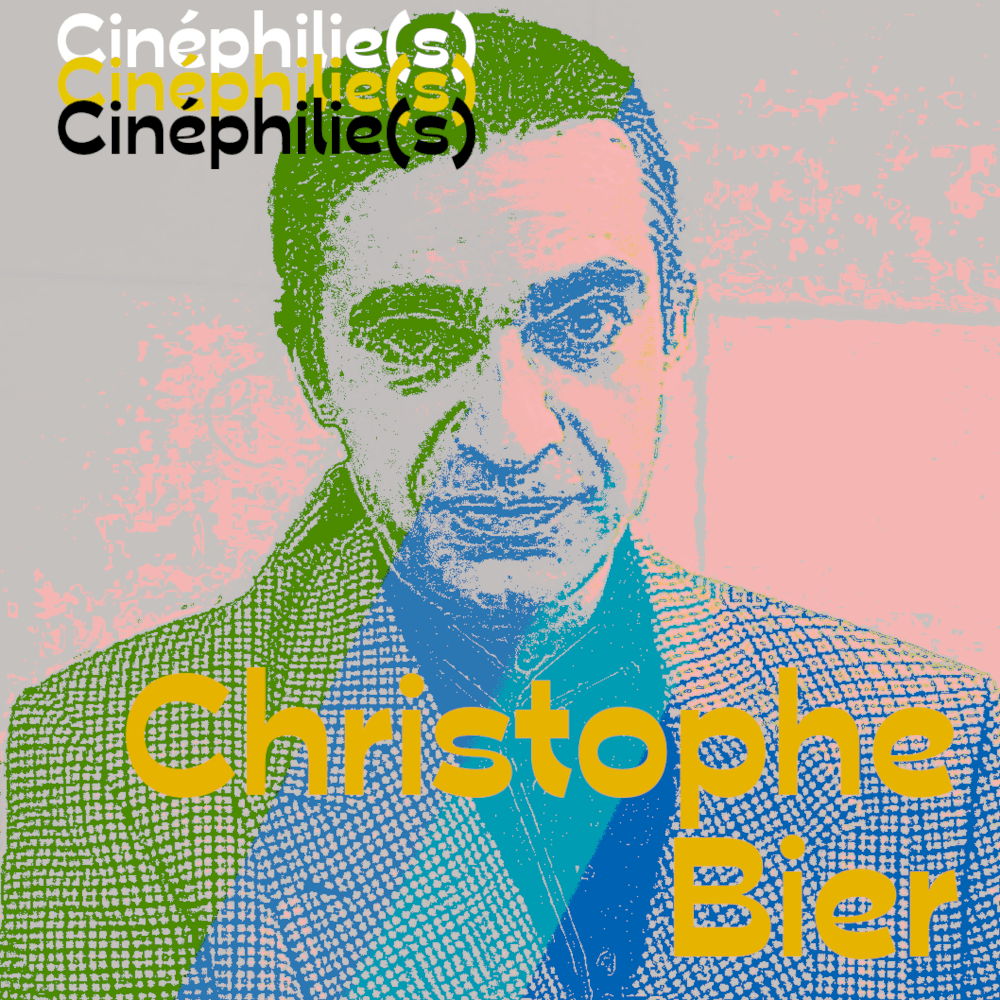
Arts | Le 9 février 2026, par Karine Josse.
« Cinéphilie(s) »
Entretiens sur la cinéphilie : une série sur l’amour du 7e art dans l’encyclopédie Sambuc
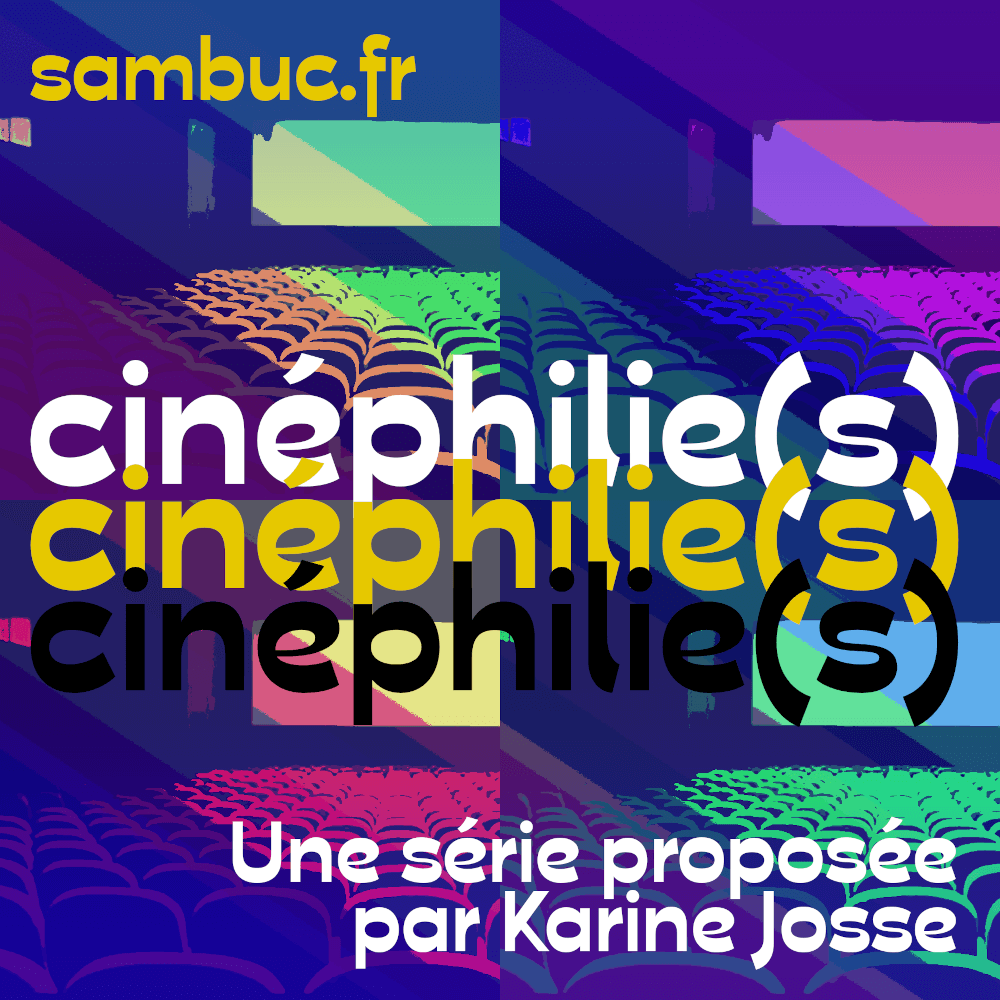
Rechercher un article dans l’encyclopédie...