Sciences humaines | Le 15 avril 2024, par Raphaël Deuff. Format : petite feuille (2 feuillets).
Langues isolantes, agglutinantes et flexionnelles
Typologie morphologique
La typologie morphologique est une classification des langues du monde en fonction de la forme des mots. Cette typologie distingue classiquement, depuis les travaux des frères Schlegel au xixe siècle, deux grandes familles de langues, isolante et flexionnelle (en anglais analytique et synthétique), selon les modifications que subissent ou non les mots de la langue avec leur fonction syntaxique.
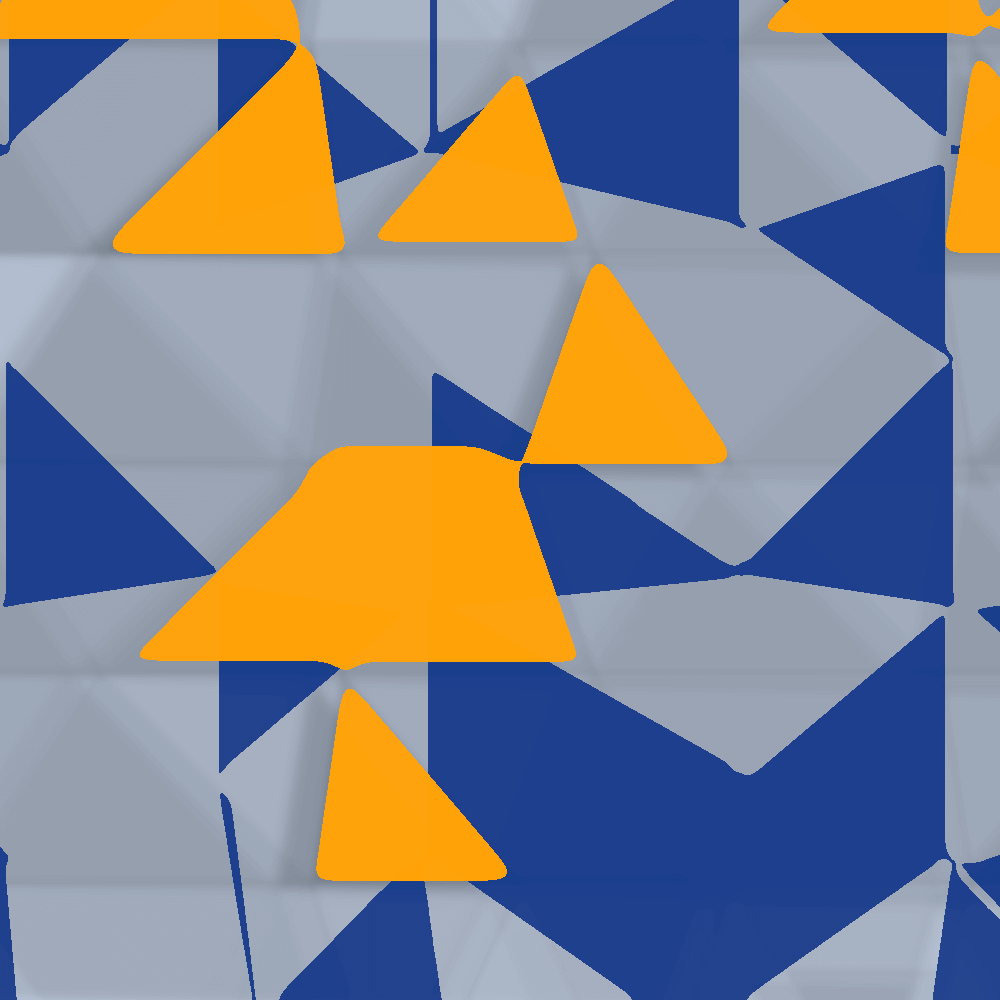
Historiquement, les premières classifications des langues naissent de la comparaison, à partir de la fin du xviiie siècle, entre les grandes langues classiques du continent indo-européen : latin, grec et sanscrit. L’instrument de comparaison, lexical, est l’étude de la formation des mots et de leur transformation d’une langue à l’autre ; le mot, et ses éléments (morphèmes) devient la première unité d’analyse des langues. Les premiers auteurs (les écrivains Schlegel, le naturaliste Humboldt) distinguent alors, dans une perspective évolutionniste, de grands types associés à l’évolution supposée des familles linguistiques.
Dans la famille des langues dites isolantes ou analytiques (dont le type classique est la langue chinoise), la phrase est formée de mots fixes, invariables juxtaposés à la suite, chacun apportant une information spécifique – sujet, nombre, genre, fonction, etc. À l’inverse, les langues flexionnelles utilisent des affixes (préfixe et suffixes) qui précisent la fonction d’un mot : pluriel, possessif, lieu, direction...
Supposées à l’origine des langues à flexion, les langues dites agglutinantes (terme forgé par Humboldt) assemblent des morphèmes fixes, au début du mot (préfixe) ou à la fin (suffixe) pour former un sens précis : à partir du terme ev, « maison », le turc construit le mot evlerim, « mes maisons », portant les marques du pluriel (ler) et du possessif (im). Enfin, dans les langues proprement flexionnelles (dites aussi fusionnelles ou synthétiques), qui constituent la grande majorité des langues indo-européennes, les formes fléchies (déclinaisons et conjugaisons) ne permettent pas toujours de distinguer la racine et les affixes ajoutés : ainsi, en français, certains pluriels de noms ou d’adjectifs, comme signaux, ne se réduisent pas à un radical signal et à une marque du pluriel, comme ce serait le cas dans une langue agglutinante ; par ailleurs, un même morphème peut exprimer différentes fonctions, comme le suffixe français -s, qui marque à la fois un pluriel, et la deuxième personne du singulier de certains temps verbaux.
En pratique, chacun de ces types morphologiques se retrouve à des degrés divers dans les langues, qui sont en général dominées par un type : le coréen est une langue fortement isolante, tandis que le turc est de type agglutinant ; en revanche, le japonais est une langue agglutinante qui possède des traits isolants, du fait d’un fort emprunt lexical au chinois. Il existe également des idiomes ou des familles d’idiome (comme les langues tupies d’Amérique du sud) dans lesquels aucun type n’est dominant.
Issue des recherches en grammaire comparée menées par les frères Friedrich von Schlegel (1772-1829) et August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) au début du xixe siècle (Sur la langue et la philosophie des Indiens, publié en 1806 ; Observations sur la langue et la littérature provençales en 1818), la typologie morphologique sera reprise et popularisée par le linguiste August Schleicher (1821-1868).
Raphaël Deuff
Indications bibliographiques
Émile Benveniste, « La Classification des langues », dans Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1952, 2e éd. 1966.
René Thom, « Sur la typologie des langues naturelles. Essai d’interprétation psycho-linguistique », dans Maurice Gross et al. (éd.), The Formal Analysis of Natural Languages, Paris/La Haye, Mouton/De Gruyter, 1973, p. 233-248.
Bernard Comrie, Language universals and linguistic typology : syntax and morphology, Chicago, University of Chicago Press, 1989.
Loïc Depecker, « Typologie des langues », Encyclopaedia Universalis, consulté en ligne (avril 2024).
Entités nommées fréquentes : Schlegel.
L’actualité : derniers articles
« Humanités numériques »
« Tu vaux mieux que ça, Scott » : au nom de la performance, un agent autonome rédige un pamphlet
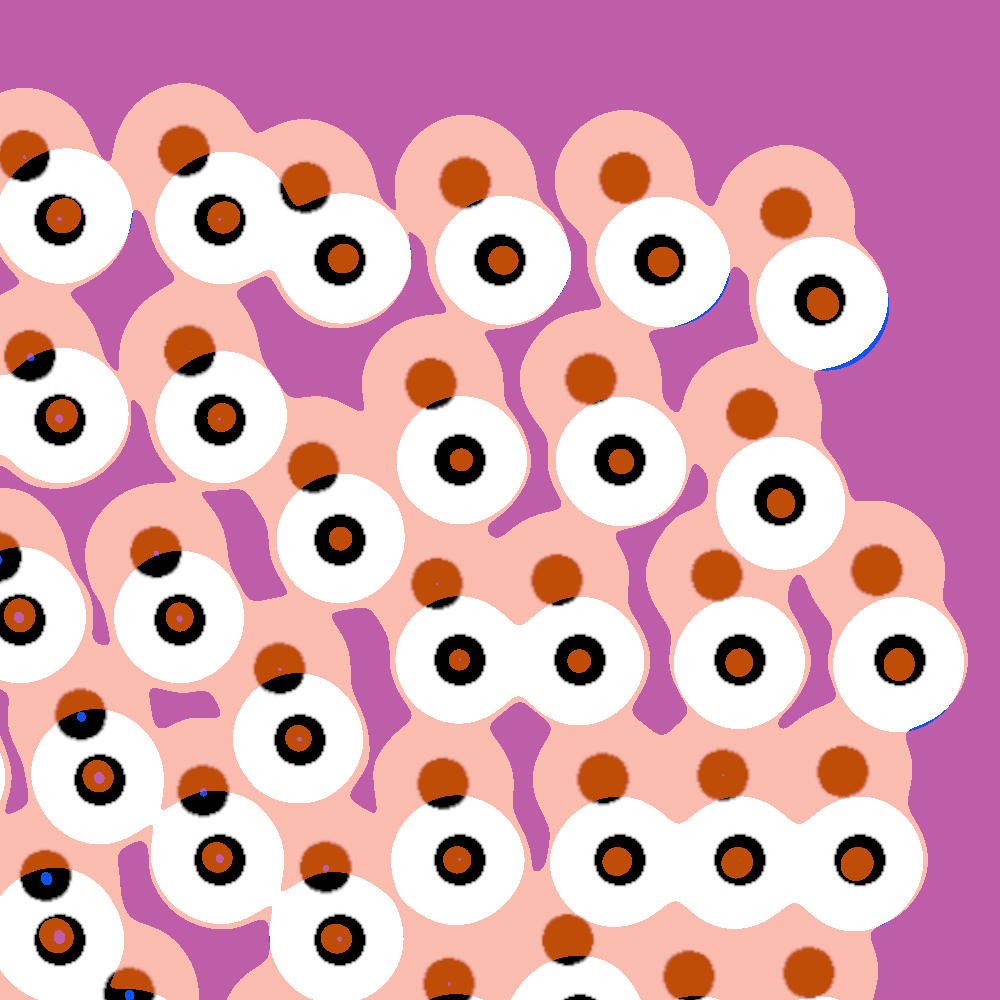
Technologie | Le 25 février 2026, par Raphaël Deuff.
« Cinéphilie(s) »
« Je suis assez matérialiste en art » : François Bégaudeau, ou comment devenir bon spectateur
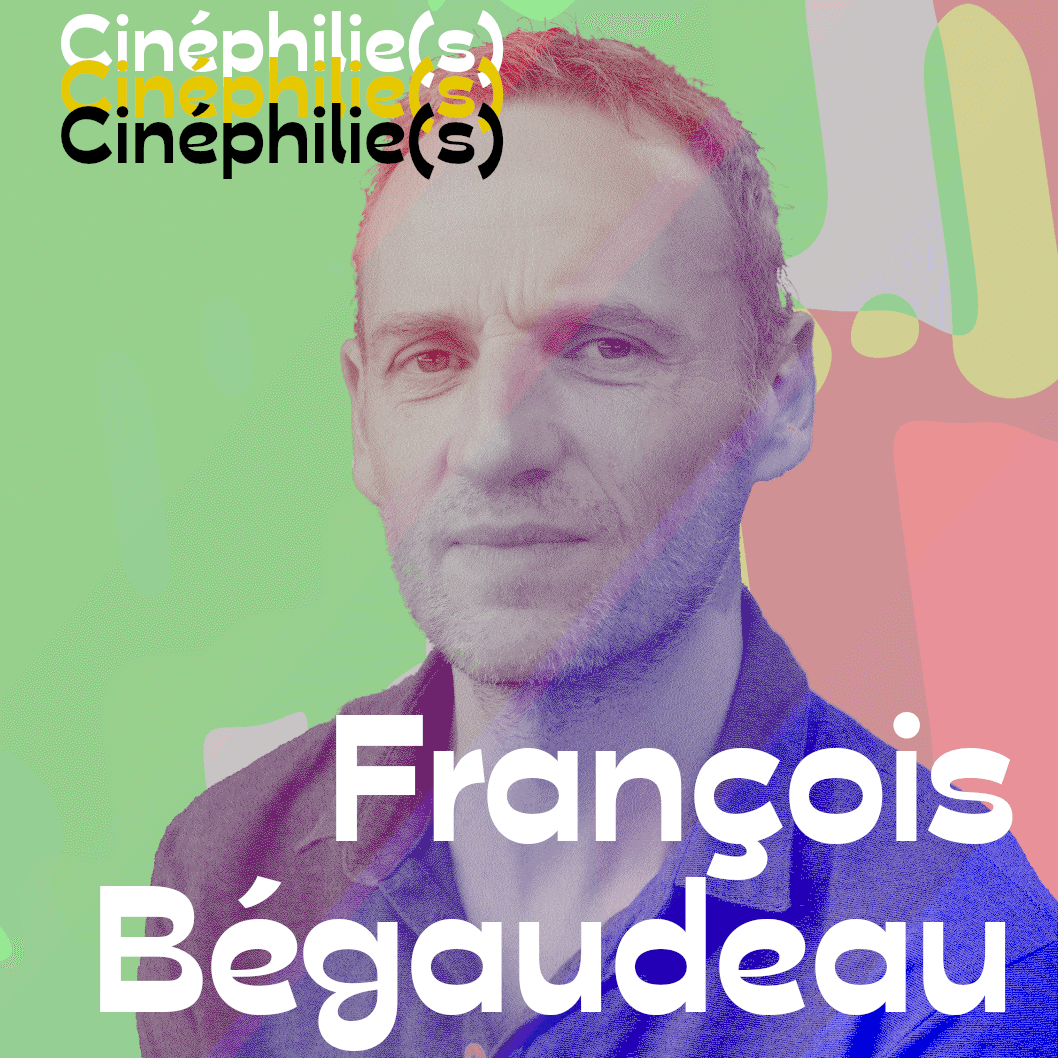
« Journal culturel »
Anniversaire de Carl Westman, architecte suédois

Arts | Le 20 février 2026, par Sambuc éditeur.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...