Sciences humaines | Le 4 janvier 2025, par Raphaël Deuff. Format : article (4 feuillets).
« Langues de France et d'outre-mer »
Kabyle
Langue vivante minoritaire
Le kabyle (taqbaylit) est une langue minoritaire de la famille des langues chamito-sémitiques, présente dans les régions françaises. Elle est usitée en Europe et en Kabylie.
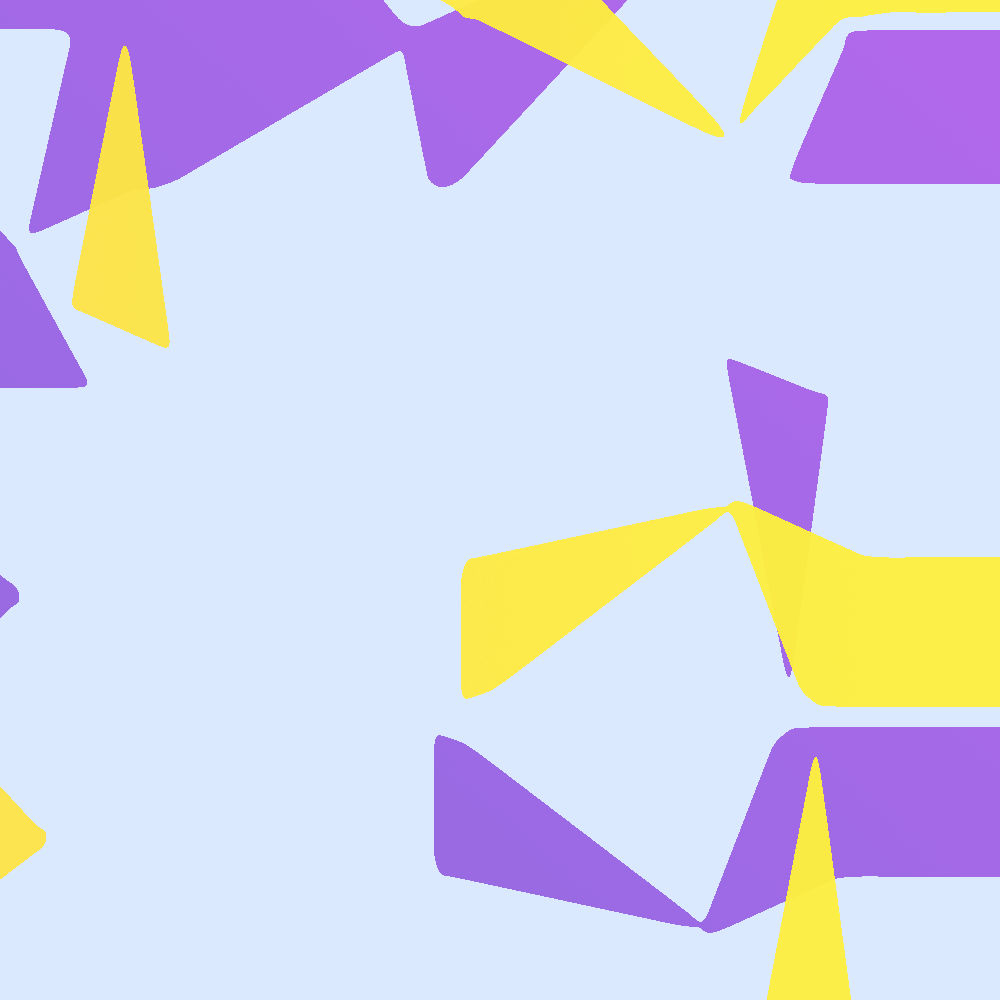
Le kabyle (taqbaylit) est une langue vivante minoritaire employée en Europe et en Kabylie. En France, la langue compte approximativement un million de locuteurs, courants ou occasionnels. Tous pays confondus, on compte de nos jours approximativement vingt-trois millions de locuteurs pour l’ensemble des langues berbères. C’est la langue historique des Kabyles.
Aspects linguistiques
Le kabyle appartient au groupe des langues berbères du nord, de la famille des langues chamito-sémitiques. Son implantation historique se situe en Kabylie.
Le kabyle est à dominante une langue VSO (ordre syntaxique verbe-sujet-objet).
Littérature
Le kabyle, comme les autres langues berbères, est doté de son propre alphabet, le tifinagh, depuis l’Antiquité (écritures libyques) ; mais la littérature en langue berbère est largement restée une littérature orale jusqu’à la deuxième moitié du xxe siècle, et les œuvres écrites l’ont été principalement dans les langues et les alphabets des peuples dominants avec lesquels ils étaient en contact : Phéniciens, Romains, Arabes puis Français.
Aujourd’hui, la langue kabyle utilise le plus souvent l’alphabet berbère latin à l’écrit (les langues berbères possèdent en outre un système d’écriture propre, l’alphabet berbère, remontant à l’antiquité).
Les premières esquisses d’études berbères occidentales remontent à la fin du xviiie siècle et aux missions scientifiques en Afrique du nord, chez des auteurs comme les Français Bory de Saint-Vincent (1778-1846) et Jean-Raymond Pacho (1794-1829), les Anglais George Francis Lyon (1795-1832) et Dixon Denham (1786-1828), ou les Allemands Friedrich Hornemann (1772-1801), Johann Martin Augustin Scholz (1794-1852) et Menu von Minutoli (1772-1846). Parmi les contributions à l’étude linguistique ou sociolinguistique des langues berbères, on mentionnera les ouvrages du linguiste Salem Chaker – « Le berbère, une langue occultée en exil » (Vingt-cinq communautés linguistiques de la France, 1988) ; Berbères aujourd’hui (1998) ; Textes en linguistique berbère (1994) ; contributions à l’Encyclopédie berbère (dir. Gabriel Camps) – et ceux de Lionel Galand (1920-2017), dont « Berbère » (Les Langues dans le monde ancien et moderne, 1988).
Les premiers auteurs à fournir des documents de grammaire spécifiques sur la langue kabyle sont le philosophe anglais Francis William Newman (1805-1897), qui publie un « Essay Towards a Grammar of the Berber Language » (West of England Journal, 1836), et le général français Adolphe Hanoteau (1814-1897), auteur d’un grand nombre d’ouvrages sur les Kabyles et leur langue, dont son Essai de Grammaire Kabyle (1858). On doit ensuite au pharmacien et linguiste kabyle Saïd Hanouz (1907-1996) de nouvelles études sur le kabyle, dont Connaissance et syntaxe du langage des Berbères (1968). À la fin du xxe siècle, le linguiste berbérisant Abdelmadjid Allaoua (Description linguistique d’un parler de Petite Kabylie, 1986) et le linguiste kabyle Kamal Naït-Zerrad (Grammaire moderne du kabyle, 2001) sont à l’origine de travaux récents sur la langue berbère de Kabylie.
La culture kabyle est de tradition orale. Adolphe Hanoteau a recueilli une littérature orale de Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura (1867), de même que le missionnaire jésuite Joseph Rivière (1853-1883) – Recueil de contes populaires de la Kabylie du Djurdjura (1882). Plus récemment, la spécialiste de littérature orale kabyle Camille Lacoste-Dujardin (1929-2016) a donné un Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie (2005), qui synthétise ses travaux portant notamment sur la littérature orale de cette région.
À partir de la deuxième moitié du xxe siècle apparaissent les premières œuvres littéraires. Parmi les romanciers modernes de langue kabyle, on peut indiquer des auteurs comme Rachid Aliche (1953-2008), Saïd Sadi ou Amar Mezdad.
Droit et institutions
La Constitution de la Ve République dispose, sur les territoires français, du français comme « langue de la République » (art. 2 modifié par la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992), ce qui prescrit l’usage du français dans la sphère publique et l’enseignement. Cet usage d’idiomes minoritaires comme la langue kabyle n’est en revanche nullement proscrit, surtout avec la reconnaissance au sein de la Constitution, depuis 2008, de leur intérêt patrimonial (art. 75-1).
Ce sont le Code de l’éducation (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11), le Code rural (L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129) et le Code de la consommation (L. 121-33) qui disposent de l’enseignement de la langue kabyle comme langue minoritaire de France. Cette langue est également enseignée à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Son usage dans les médias et dans la sphère publique est édicté au sein de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ou loi Toubon.
Dans certains pays du continent européen, cette langue est aussi protégée au titre de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires (1992) : en Espagne (II, art. 7).
L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM, Maroc) et le Haut Commissariat de l’amazighité (HCA, Algérie) comptent au nombre des institutions qui promeuvent la langue kabyle, son enseignement et sa pratique aujourd’hui.
Raphaël Deuff
Notice synthétique
Nom français : kabyle
Autonyme : taqbaylit
Nom anglais : Kabyle (Amazigh, Greater Kabyle, Lesser Kabyle, Tamazight, Taqbaylit, Tasahlit)
Statut : langue vivante minoritaire
Territoires d’implantation : Kabylie
Systèmes d’écriture : alphabet berbère latin (transcription), alphabet berbère
Famille linguistique : langues chamito-sémitiques
Typologie linguistique : VSO/SVO
Notices d’autorité et bibliographiques : kaby1243 (Glottolog.org), kab (ISO 639-3). Parent : kaby1244 (Glottolog.org)
Ressources et portails
Portail : Institut royal de la culture amazighe (IRCAM, Maroc) (ircam.ma)
Portail : Haut Commissariat de l’amazighité (HCA, Algérie) (hcamazighite.dz)
Ressource : Kabyle – kab (iso639-3.sil.org)
Ressource : Kabyle – kaby1243 (glottolog.org)
Ressource : Kabyle-Atlas Berber – kaby1244 (glottolog.org)
Ressource : Kabyle (Berbère) (inalco.fr)
Ressource : Berbère (langues berbères) (inalco.fr)
Ressource : OLAC resources in and about the Kabyle language (language-archives.org)
Ressources bibliographiques
Bernard Cerquiglini, Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 1er avril 1999. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Christos Clairis, Denis Costaouec et Jean-Baptiste Coyos (dir.), Langues et cultures régionales de France, Paris, L’Harmattan, 2000.
Henri Giordan (dir.), Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, Kimé, 1992. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Henri Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport présenté à Jack Lang, ministre de la Culture, Paris, La Documentation française, 1982. Notice en ligne (catalogue.bnf.fr).
Henri Giordan et al., « Les langues de France », Tribune internationale des langues vivantes, Paris, 2000.
Wolfgang Jenniges (éd.), Select Bibliography on minority languages in the European Union / Bibliographie sélective des langues minoritaires de l’Union européenne, Bruxelles, Bureau européen pour les langues moins répandues, 1997. Notice en ligne (europeansources.info).
Benoît Paumier et al., Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication, 17 juillet 2013. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Jean Sibille, Les Langues régionales, Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000.
Geneviève Vermès (dir.), Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (2 vol.), Paris, L’Harmattan, 1988. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Texte de référence : Constitution du 4 octobre 1958 (legifrance.gouv.fr), art. 2 et 75-1
Enseignement
Texte de référence : Code de l’éducation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11
Texte de référence : Code rural (legifrance.gouv.fr), art. L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129
Texte de référence : Code de la consommation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-33
Médias et sphère publique
Texte de référence : Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (legifrance.gouv.fr), dite « loi Toubon »
Entités nommées fréquentes : Kabylie, Code, France, Institut, Kabyle, Berbère, Europe, Paris, Giordan, Culture, Constitution.
L’actualité : derniers articles
« Humanités numériques »
« Tu vaux mieux que ça, Scott » : au nom de la performance, un agent autonome rédige un pamphlet
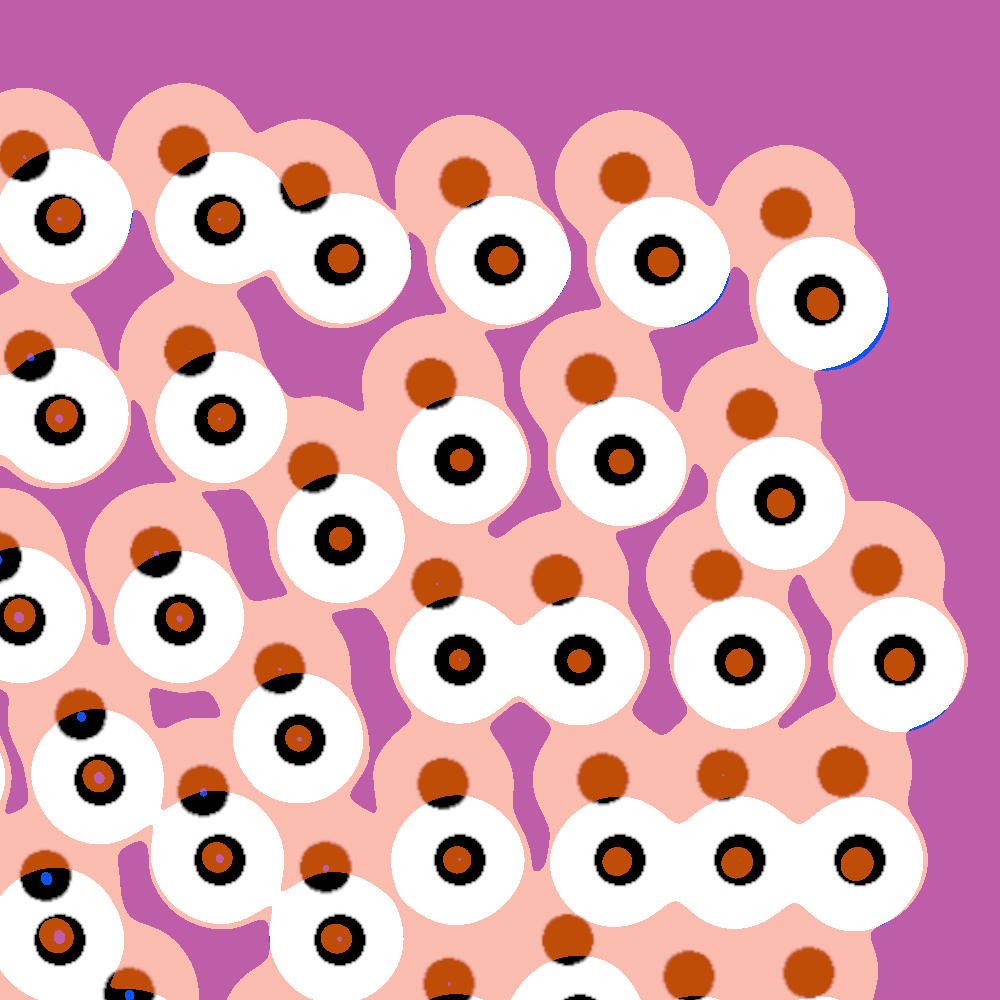
Technologie | Le 25 février 2026, par Raphaël Deuff.
« Cinéphilie(s) »
« Je suis assez matérialiste en art » : François Bégaudeau, ou comment devenir bon spectateur
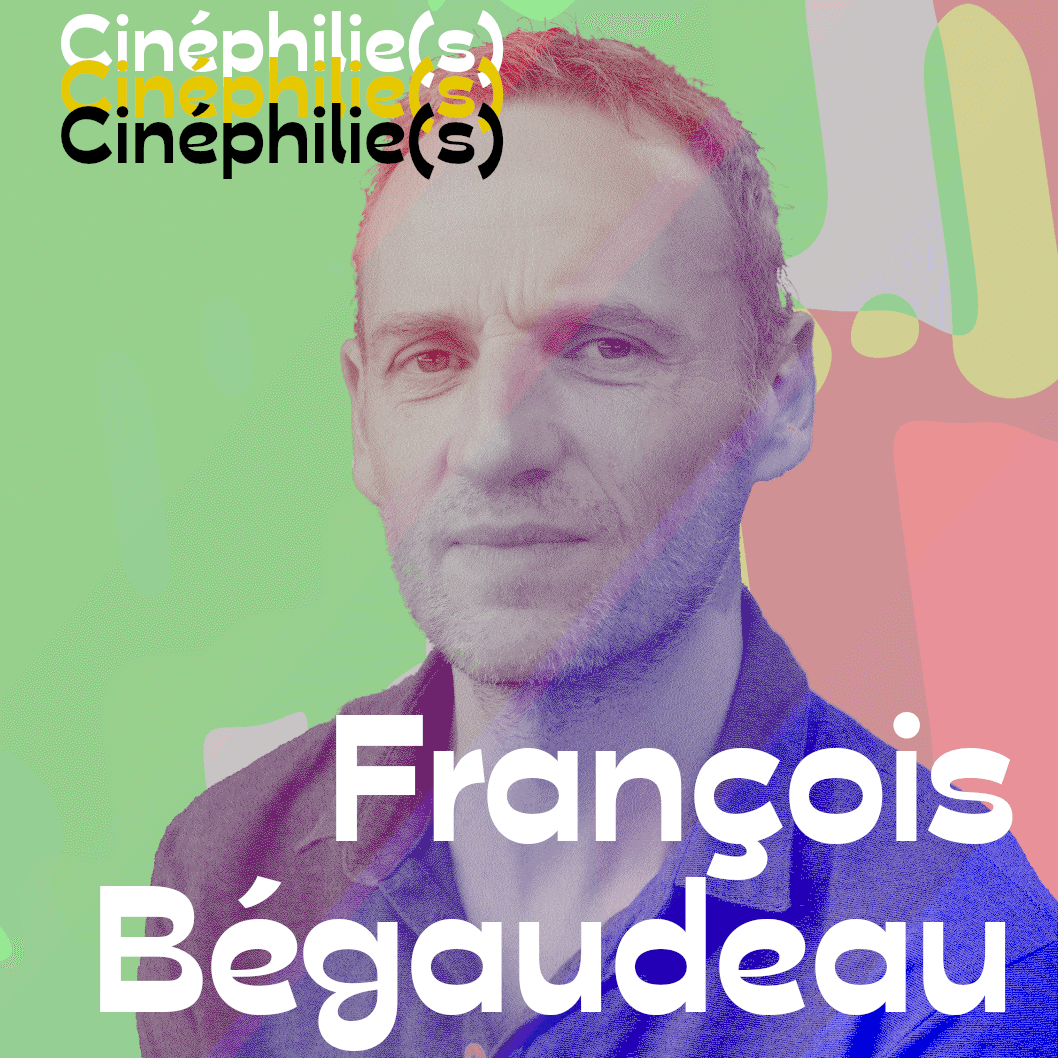
« Journal culturel »
Anniversaire de Carl Westman, architecte suédois

Arts | Le 20 février 2026, par Sambuc éditeur.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...