Sciences humaines | Le 7 janvier 2025, par Raphaël Deuff. Format : article (5 feuillets).
« Langues de France et d'outre-mer »
Langue des signes française
Langue vivante minoritaire sociolectale
La langue des signes française, couramment abrégée LSF, est une langue des signes (sociolecte visuogestuel) utilisée en France et en Suisse par les personnes sourdes et malentendantes.

La langue des signes française, aussi appelée LSF, est une langue minoritaire parlée comme sociolecte. Au sein des territoires de France, la langue est employée par 200 000 locuteurs approximativement, courants ou occasionnels. C’est la langue maternelle des personnes sourdes de France et de Suisse.
Linguistique
La LSF appartient au groupe des langues des signes françaises (variantes historiques et géographiques), dans la famille des langues des signes. Cette langue prend forme dans les régions françaises, sans faire l’objet d’une normalisation avant le xxe siècle ; elle est issue pour partie de la vieille langue des signes française, dont les premières attestations remontent au xviiie siècle.
La LSF est de structure syntaxique à dominante SOV, soit une syntaxe sujet-objet-verbe.
Littérature de la langue des signes française
Dotées d’un mode d’expression distinct des langues orales, organisé en « chérèmes », les langues des signes sont aujourd’hui des langues sans écriture. En outre, les populations sourdes (personnes sourdes de naissance en particulier) ont une difficulté beaucoup plus grande que les entendants et malentendants dans l’alphabétisation et l’accès à la littérature ; à la fin des années 1980, une étude de l’Association des Sourds du Canada publiée par le ministère de l’Éducation au Québec établissait que le taux d’analphabétisme chez les personnes sourdes constituait plus du double de celui de la population générale (65 % chez les sourds de naissance, contre 30 % en général)1.
Un art spécifique aux langues signées, le chansigne (sign singing en anglais), forme toutefois un répertoire en langue des signes dans le genre poétique, semblable à une littérature de tradition orale.
Du point de vue de la culture sourde enfin, le relieur Pierre Desloges (1742-1792) est considéré comme le premier auteur sourd. En novembre 2022, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a consacré un opus de ses Ateliers du livre aux rapports entre la langue des signes française et la littérature2.
Le prêtre français Charles-Michel de L’Épée (1712-1789), précurseur de l’enseignement spécialisé dispensé aux sourds, est l’auteur d’observations portant sur la vieille langue des signes française au xviiie siècle, à laquelle il emprunte des éléments signés pour construire son « langage de signes méthodiques ». L’analyse proprement linguistique de la langue des signes s’élabore ensuite à travers un détour par les États-Unis : le linguiste américain William Stokoe (1919-2000) est le premier à reconnaître dans l’American Sign Language (ASL) les équivalents d’une construction morphosyntaxique et d’une phonologie. L’ASL s’est élaborée au cours du xixe siècle au sein de l’école fondée par Thomas Gallaudet en 1817. William Stokoe donne en 1960, dans un article, son analyse de la langue des signes américaine et de ses unités minimales non significatives, équivalent signé des morphèmes qu’il baptise « chérèmes » (« Sign Language Structure », Studies in linguistics, University of Buffalo).
Vers la même période, le professeur français Rémi Valade (1800-1890) publie des Études sur la lexicologie et la grammaire du langage naturel des signes (1854), qui décrit pour la première fois la langue signée effectivement employée par les sourds en France.
Le titre sous lequel je publie ce travail indique assez que mes observations ne se rapportent point aux signes méthodiques dont faisaient usage l’abbé de l’Épée et l’abbé Sicard, nos illustres devanciers. Ce système (je ne saurais dire cette langue), à bon droit tombé dans le discrédit, consistait à traduire exactement, signe pour mot, le discours parlé, sans rien changer à l’ordre des parties. (...)
Entre le langage des signes ainsi déshonoré et le langage des signes objet de ces études, il n’y a rien de commun. Ils diffèrent l’un de l’autre comme les ténèbres de la lumière, comme la servitude de la liberté. Embarrassé dans ses liens, le premier se traîne pénible ment, réglant sa marche sur celle de la parole, couvrant ses pas de ses pas. Chez lui, tout est emprunté, tout est factice; on n’y sent ni chaleur, ni vie. Rien, au contraire, dans le second ne gêne la vivacité des allures et la spontanéité des mouvements. Il a son génie, ses lois, ses formes, ses idiotismes : il vit de sa vie propre.
Rémi Valade, Études sur la lexicologie et la grammaire du langage naturel des signes, 1854.
L’intérêt pour l’étude des langues des signes s’est particulièrement accru à partir de la deuxième moitié du xxe siècle. En 1983, l’interprète en langues des signes Bill Moody dirige la publication d’une monographie sur La langue des signes (t. 1 : Histoire et grammaire). Quelques années plus tard, le linguiste François-Xavier Nève (1946-2022) est l’auteur d’un Essai de grammaire de la langue des signes française (1996). L’enseignante Agnès Millet publie également en 2019 une Grammaire descriptive de la langue des signes française.
Des Écrits sur la langue des signes française, laissés par l’éducateur Paul Jouison (1948-1991), ont également été publiés de façon posthume en 1995.
Droit et institutions
Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit.
Code de l’éducation, art. L112-2-2.
La Constitution de la Ve République dispose, pour la France : « La langue de la République est le français. » (art. 2 modifié par la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992), ce qui exclut que quiconque se puisse prévaloir d’un droit à employer une autre langue que le français. Cet usage de sociolectes comme la langue des signes française n’est toutefois pas écarté du droit français, d’autant plus avec la reconnaissance de l’importance patrimoniale des langues minoritaires par l’article 75-1 de la même Constitution introduit en 2008.
Depuis 2005, un dispositif normatif spécifique, la loi du 11 février 2005, permet à la langue des signes française d’être reconnue comme langue et enseignée dans le primaire et le secondaire, et de faire l’objet d’une épreuve facultative au baccalauréat. Au reste, comme les autres langues minoritaires françaises, son enseignement a pour cadre légal le Code de l’éducation (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11), le Code de la consommation (L. 121-33) et le Code rural (L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129).
Son emploi dans la sphère publique et dans les médias est essentiellement normé au sein de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ou loi Toubon et la loi no 2005-102 du 11 février 2005.
Parmi les organismes promouvant actuellement la LSF, son enseignement et sa pratique, on compte l’Institut national des jeunes sourds et l’International Visual Theatre (IVT).
Raphaël Deuff
Notice synthétique
Noms français : langue des signes française, LSF
Nom anglais : French Sign Language (FSL, Langue des Signes Française, LSF, Marseille Sign Language, Southern French Sign Language)
Statut : langue vivante minoritaire sociolectale
Territoires d’implantation : France et Suisse
Famille linguistique : langue des signes
Typologie linguistique : SOV (OSV/SVO dans une moindre mesure)
Notices d’autorité et bibliographiques : fren1243 (Glottolog.org), fsl (ISO 639-3). Parent : lsfi1234 (Glottolog.org)
Ressources et portails
Portail : Institut national des jeunes sourds (injs-paris.fr)
Portail : International Visual Theatre (IVT) (ivt.fr)
Ressource : French Sign Language – fsl (iso639-3.sil.org)
Ressource : French Sign Language – fren1243 (glottolog.org)
Ressource : LSFic – lsfi1234 (glottolog.org)
Ressource : OLAC resources in and about the French Sign Language (language-archives.org)
Ressources bibliographiques
Bernard Cerquiglini, Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 1er avril 1999. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Christos Clairis, Denis Costaouec et Jean-Baptiste Coyos (dir.), Langues et cultures régionales de France, Paris, L’Harmattan, 2000.
Henri Giordan (dir.), Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, Kimé, 1992. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Henri Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport présenté à Jack Lang, ministre de la Culture, Paris, La Documentation française, 1982. Notice en ligne (catalogue.bnf.fr).
Henri Giordan et al., « Les langues de France », Tribune internationale des langues vivantes, Paris, 2000.
Wolfgang Jenniges (éd.), Select Bibliography on minority languages in the European Union / Bibliographie sélective des langues minoritaires de l’Union européenne, Bruxelles, Bureau européen pour les langues moins répandues, 1997. Notice en ligne (europeansources.info).
Benoît Paumier et al., Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication, 17 juillet 2013. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998. Lire en ligne (vie-publique.fr).
Jean Sibille, Les Langues régionales, Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000.
Geneviève Vermès (dir.), Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (2 vol.), Paris, L’Harmattan, 1988. Compte-rendu en ligne (persee.fr).
Texte de référence : Constitution du 4 octobre 1958 (legifrance.gouv.fr), art. 2 et 75-1
Enseignement
Texte de référence : Code de l’éducation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-1, L. 121-3, L. 123-6, L. 312-10 et L. 312-11, ainsi que L. 312-9-1
Texte de référence : Code rural (legifrance.gouv.fr), art. L. 811-5, L. 813-2 et R. 811-129
Texte de référence : Code de la consommation (legifrance.gouv.fr), art. L. 121-33
Texte de référence : Loi no 2005-102 du 11 février 2005 (legifrance.gouv.fr), art. 19, 75
Médias et sphère publique
Texte de référence : Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (legifrance.gouv.fr), dite « loi Toubon »
Texte de référence : Loi 2005-102 du 11 février 2005 (legifrance.gouv.fr), art. 19, 75
Notes
Note 1. Ministère de l’Éducation, Document de référence pour l’alphabétisation des personnes ayant une déficience auditive, Direction générale des programmes, Service d’alphabétisation, Direction de la formation générale des adultes, Québec, Les publications du Québec, 1991. Étude menée en 1988 par l’Association des Sourds du Canada (cad-asc.ca).
Note 2. Ressource numérique : La langue des signes française et le livre, colloque de la Bibliothèque nationale de France (youtube.com)
Entités nommées fréquentes : France, LSF, Code, Suisse, French Sign Language, Paris, Giordan, Culture, Constitution, Loi, Éducation, Les, Québec, La.
L’actualité : derniers articles
« Journal culturel »
Adelcrantz, Adelbert von Chamisso et Teresa Ries : découvrez trois artistes et écrivains
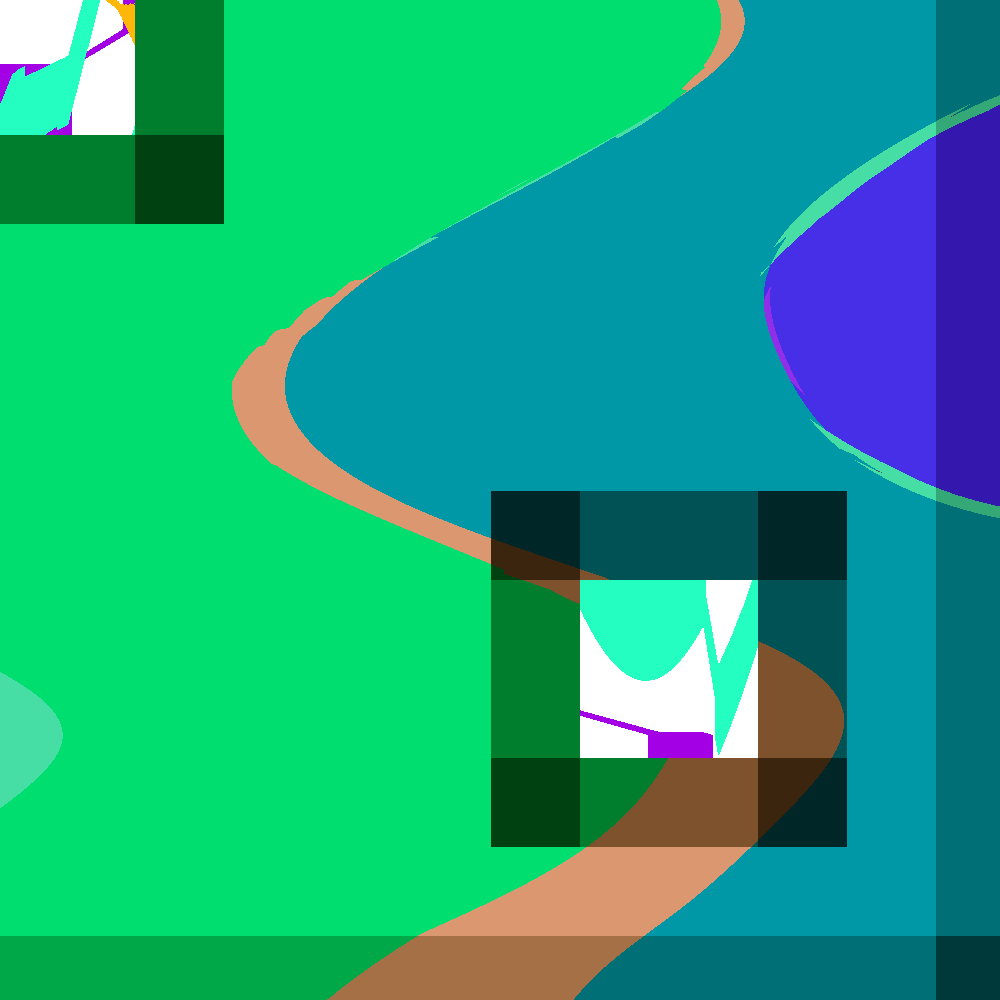
Actualités culturelles | Le 30 janvier 2026, par Luc Grampivf.
« Faune urbaine »
Le retour discret de la loutre d’Europe sur le Lez

Nature et biologie | Le 30 janvier 2026, par André Roussainville.
nature et biologie
Loutre d’Europe

Nature et biologie | Le 30 janvier 2026, par Sambuc éditeur.
Rechercher un article dans l’encyclopédie...